



Wauthier-Braine, qui se trouve en aval de Braine-l’Alleu, sur le Hain, a changé son nom primitif de Braine (Brainne, 1231 ; Brena, 1233) en sa dénomination actuelle, sans doute d'après un chevalier qui y avait sa résidence. On a dit : en latin Brania Walteri ou Braine de Walter (1225, 1232, 1250, 1280, 1441), Walteri Brania (1235), Walteri Brenna (1237) ; en français, Wautier Braine (1270, 1283, 1617, 1787), Watier Braine (1230, 1280, 1498), Walier Brainne (1300, 1401), Woutre Brayne (1334), Wautier Braysne (1357), Waultier Braine (1403), Wati Braysne (1439), Waulty Braine (1483) ; en flamand, Wouter Braken (1374) ou Wouters Brachene (1464). On prononce en wallon Hôtie-Braine.
La commune de Wauthier-Braine est limitrophe de celles de Hal, Braine-l'Alleu, Ophain, Haut-Ittre et Braine-le-Château.
Wauthier-Braine est à 2 1/2 kilomètres de Braine-le-Château, 4 1/2 k. d'Ophain et de Haut-Ittre, 5 1/2 k. de Braine-l'Alleu, 9 k. de Hal, 10 1/2 k. de Nivelles, 24 1/2 k. de Bruxelles.
L'église de Wauthier-Braine se trouve située par 56 grades 31 de latitude N. et 2 grades 18 de longitude E.
L'altitude du seuil de la porte de l'église est de 66 mètres.
Le cadastre divise le territoire de Wauthier-Braine en 3 sections : la section A ou du Village, la section B ou de Noucelle, la section C ou de Nizelle.
Au 1er janvier 1859, ces sections se trouvaient morcelées en 1,.275 parcelles, appartenant à 294 propriétaires, donnant un revenu cadastral de 44,305-89 fr. (sol : 35,954-89 ; bâtiments : 8,351-00) et ayant une contenance de 839 hectares 10 ares 95 centiares (imposable : 821 hect. 40 a. 95 ca. ; non imposable : 17 hect. 70 a. 00 ca.).
Cette contenance globale se subdivisait ainsi en 1834 :

On comptait à Wauthier-Braine, en 1374, 51 ménages, plus 19 dans la seigneurie des Aa, à Noucelle ; en 1436 et 1464, 68 foyers; en 1472, 71 loyers ; en 1492, 36 foyers ; en 1526, 55 maisons, dont 1 inhabitée et 2 à deux foyers, et outre l'abbave où habitaient 146 personnes; en 1686, 20 maisons, 1 moulin, 2 tavernes, 2 brasseries ; au 31 décembre 1856, 295 maisons.
Le village de Wauthier-Braine, qui compte 123 maisons ; la Haute-Noucelle, 69 maisons ; la Basse-Noucelle, 88 maisons ; Colipain, 15 maisons.
Le petit village de Wauthier-Braine s'élève, à l'extrémité occidentale du territoire de la commune, sur les deux rives du Hain ; il est longé par la route de Tubise à Waterloo, au S. de laquelle on voit encore les bâtiments d'une ancienne abbaye : Notre-Dame de Braine ou Braine Notre-Dame (Beatæ Mariæ de Brania, 1234 ; Brania Beatæ Mariæ, 1236), servant aujourd’hui de local à une filature de coton.
La Haute-Noucelle, ou Noucelle proprement dite (Nocela, 1232 ; Noucelle, 1253, 1280, 1586, 1787 ; Nouselle, 1296 ; Haute-Nourselle, 1335 ; Nourselle, 1392 ; Nousselle, 1422, 1438 ; Ursele, 1477 ; en flamand, Hoghe Oerselle, 1358), est un hameau situé vers la limite orientale de la commune, à 1,900 m. E. de l'église ; il occupe la pente d'une colline assez élevée qui est entourée de bois de tous côtés, sauf vers le N., où coule le Hain.
La Basse-Noucelle, que l'on nomme aussi la Bruyère ou les Communes, se trouve à environ 1,200 m. N.-E. de l'église, sur une colline dont le pied est baigné par le Hain.
Le hameau de Colipain forme le prolongement septentrional de la Basse-Noucelle ; il se compose de quelques maisons situées à 2,000 m. N-N.-E. de l'église, près de la limite de Braine-l'Alleu, au-delà de laquelle on rencontre encore plusieurs habitations qui portent le nom de Colipain.
A 1,100 m. N. de l'église, la Court-au-Bois (Court à bos, 1428), ferme ; à 700 m. N., la Maison du Bosquet ; à 1,400 m. N.-E., la ferme de Hardichamp ou Arduchamp ; à 1,800 m. N.-E., les Maisons Gouvart ; à 900 m. N.-E., la Ferme del Borre ; à 1,000 m. E.-N.-E., la Filature Taminiaux ; à 1,900 m. E.-N.-E., le Moulin Linard, autrefois de Bourlamont ou Bourlarmont (Bourlarmont. 1280, 1366, 1574 ; Bourlamont, 1299, 1374,1531, 1748 ; Borlarmont, 1299 ; Bollanmont, 1312 ; Borlamont, 1422, 1440 ; Bolarmont, 1440, 1551) ; à 2,300 m. E., la Ferme Querton ; à 1,200 m. E., la Maison Charles de Dieudonnée ; à 1.500 m. S.-E., le Rosoir (Cense de Rosoir, 1392 ; Rasoet, 1395 ; Rousoit, 1408 ; Rousoy, 1483 ; Rosoir, 1772), en wallon, Rousoi, plus connu aujourd'hui sous le nom de Ferme Chamarais ; à 1,600 m. S.-E., la Maison du Bois ; à 2,000 m. S.-S.-E., la Ferme de Nizelle (Mets de Nyselle, Maison de la Chapelle de Nyselle, 1408 ; Haute-Nizelle, 1450 ; Fief de Nizelle ; à 900 m. S.-S.-E., le Baudet ;— à 1,600 m. S., le Sacrement (Bruyère du Sacrement, 1618) ; à 900 m. S., le Rond Bosquet ; à 1,500 m. N.-N.-O., Malavisée, ancienne ferme.
Quarante bonniers ; Sept bonniers vis-à-vis la Maison du garde ; Grande campagne de la Court-au-Bois ; Quatre bonniers d'Asain (Eysinghen?) ; Bois du Voilard ou du Duc d'Arenberg ; Près de la Forêt de Soigne ; Campagne du Ri des Champs ; la Couture ; Bois des Pauvres ; Cantine ; Commune de l'Abbaye ou Bruyère de l'Abbaye ; Au-dessus de l'Abbaye ; Abbaye ; Long brou ; Champ de la Cure ; Champ Binet ; Bougnipré ; Bois Bougni, ou Boignée, ou Saint-Joseph (Boignées, 1463 ; les Boignées, 1479 ; au Boignies) ; Pré de la Cantine ; le Perge ; Bruyère d'Hardichamp ; les Pistouillettes ; Champ de la Chapelle ; Hurtebise ; Bois des Huit bonniers ; les Graisseries (al Graisserie, 1773) ; Au Moulin : Près du Moulin ; Fond d'Erdoute (des Redoutes?) ; Pré de Boularmont ; Bois de Noucelle, ou de Boularmont, ou de Hautmont (Bruyères dites les Haulxmons, 1504 ; Homont, 1483 ) ; Onze bonniers ; Campagne du Sart (Silva de Sartis , terra de Sartis, 1280) ; Bruyère de Noucelle ; Champ Poirier (Perir, 1408 ); Dix bonniers ; Campagne Saint-Antoine ; le Sape (terre à le Sape) ; Bois du Moulin ; Chemin de Nivelles (Grand chemin de Bruxelles à Nivelles, 1483) ; Trou à la Vache ; Escavée ; Pont del Borre ; Chemin d'Alsemberg ; le Sort ; Chemin de Screce ; Ferme du Chênoit (Chenoit, 1422 ; terra dicta keynoit, 1456) jadis Cense Leclerc? ; Maison Wittebore ; Chemin d'flamme ; Maison Boch ; Maison Henri Chabeau ; Sentier Fiévez ; Maison Duhoux ; Maison Lacroix ; Maison Gossieau ; Sentier de l'Ermitage ; Etangs du Curé ; Maison du Tri ; Maison Depré ; Planche ; la Praie ; Haut Jardin ; Pont du Village ; Chapelle Saint-Joseph ; Chapelle N.-D. de Foi ; Chapelle Saint-Roch ; Chapelle Querton ou des Saints Jean et Ghislain, Cornelis.
Ermitage ou Chapelle Sainte-Aldegonde, Baniche haye (1280) ou Banisse haie(1283) ; le Bayart ou Baïart (1422, 1505, 1729) ; près des Boignées ; Pré des Béghines (1484) ; au Biloit ; ter Binnen Brugghen ; pré dit Bonaerthof (1358); Bosquet de l'abbaye (an V) ; Bruneken ou Brunken, à Haute-Nizelle (1450, 1467) ; l'Emblème (an V, L’Ebbelme, 1470) ; Flacamp (1484) ; Geeraert heyde (1435) ; pâturage dit le Girsart (1460) ; Pâtures de Gloriette (1435, 1456) ou maison dite la Gloriette (1782) ; Grand champ (an V) ; le Granhu (1364) ou Grehut (1407), près du Rosoir ; Champ al Haise (1773) ; Herdersvelt (1406) ; Hergrefcamp (1393) ; Viviers de Hollaerts, près du Vroimpré (1531) ; Housoit le Val (1408, 1409) ; Pré de Hurtebise, devant l'église abbatiale (1469) ; Bois Hustyn, joignant à l’Ebbelme (1470) ; Tenure Huwellet, à Basse-Noucelle (1430) ; Fonteyne al Kaisne (1408) ; Lydrinchamp (1393; Closière de Liederchamp, 1623 ); Le Duc (an V) ; Maison à la Loge, entre Nizelle et Braine-le-Château (1465) ; Lomont (1408) ; Longue Bruwière (1593) ; Bois de le Loyse, qui se trouvait entre les bois de Soigne, de Hal et de Hollart, et qui fut vendu, le 1er juillet 1474, à l'abbaye de Wauthier-Braine, par EIze De le Loyse (ou De.Loose), dame de Steenockerzeel ; Bosquet del Marre (1623); Fief le Ministre, à Nizelle (1470) ; Try du Mont (1508) ; Pré Mosseleman, à côté du Vroimpré et du chemin allant du pont vers les bruyères (1470) ; Ter Motten (1357) ou La Motte ; Al haye à Nemerputte (1479) ; Nizelbrouck (1484); Oudain fontaine (1772) ; Bois dit à Patrion (1469) ; Tri Saint-Pierre (1467) ou Pré Saint-Pierre (1508), à Nizelle ; bois dit Pré al Dime (1773) ; Pré le Pouche (an V) ; Op 't Quelterkyn ( 1393) ; Pré des Queues (an V) ; Puttepanche, près le Granhu (1364, 1456, 1490) ; Quiertte quint (an V) ; pâturages dits Ripain (1456) ; Ronde Epinne, près de Nizelle (1480) ; Pré al Saive (1429) ; Closière Sablonneuse (an V) ; Sars de la Bansse haie (1283) : Te Saybrouc ; Stockoit (1393) ; Au Tonboit (1469) ; Ferme VanderKelen (1787) ; Maison delle Vallée (1469) ; Veronpré (1472, 1640), ou Vroimpré (1534) ; Vieux chemin, joignant le Vroimpré (1664) ; Ten Cleynen Warissaert ; Swyngaerts huys (1393 ); Ysaybrouke, près de la chapelle Sainte-Audegon (1420) ; à la limite de Wauthier-Braine vers Ophain, la Scaillée à Nizelle, la Chambre de Bastin, le Chesne aux chiens, la Longue saulx (1596).
Le terrain est généralement accidenté et peu fertile, aussi a-t-on respecté une assez grande partie des bois qui couvraient le territoire de Wauthier-Braine. Le point culminant paraît être au S. de la Haute-Noucelle, vers la lisière S.-E. du bois de Hautmont.
Le sol est constitué presqu'uniquement par le système bruxellien, qui règne sur toutes les collines, mais qui fait place au système laekenien sur le plateau voisin du bois de Hautmont. La vallée du Hain appartient au système gedinnien, qui est entièrement recouvert par le limon hesbayen du système diluvien ; entre le terrain gedinnien et le terrain bruxellien se montrent, à mi-côte, en une bande étroite, les deux étages du système yprésien. Le limon hesbayen cache une partie de cet affleurement et revêt aussi une partie du système bruxellien, dans le voisinage de la Court-au-Bois.
On extrait un peu de marne pour les besoins de l'agriculture ; une petite sablière est exploitée à Colipain. Un octroi du 8 novembre 1764 autorisa le vicomte de Sandrouin à fouiller le sol pour y chercher de la houille, aux environs de Wauthier-Braine et de là, par Mont-Saint-Jean jusqu'à Ceroux, par Bois-Seigneur-Isaac jusqu'à Thines, et le long de la Dyle jusqu’a Bierbais ; mais, en 1781, le conseil des finances ordonna l'annulation de cet octroi, qui n'avait probablement produit aucun résultat.
Tout le territoire de Wauthier-Braine appartient au bassin de l'Escaut ; les cours d'eau qui arrosent cette commune sont : le Hain, le Ri du Charron, le Ri du Longbrou, le Ri al Mâle, le Béguin, le Bi de Hautmont et le Ri des Vervois.
Le Hain vient de Braine-l'Alleu ; à peine entré sur le territoire de Wauthier-Braine ii active le moulin Linard par une chute de 2 m. 50 ; reçoit ensuite le Béguin (r. g.) ; active la filature Taminiaux par une chute de 1 m. 89 ; puis reçoit la fontaine del Borre (r. dr.), le Ri al Mâle (r. dr.) et le Ri du Charron (r. g.) ; se grossit (r. dr.) des eaux d'une petite source venant de l'Escavée ; coule entre l'église et l'ancienne abbaye de Wauthier-Braine, dont il active le moulin et la filature par des chutes de 3 m. 47 ; puis passe sur le territoire de Braine-le-Château. Son cours, dirigé de l'E.-S.-E. à l’0.-S.-O. a un développement de 2,900 mètres. La pêcherie dans la rivière était encore, en 1342, une annexe de la seigneurie de Bourlamont, bien que dès le mois de janvier 1289-1290, le chevalier René de Bourlamont eût déclaré qu'elle appartenait à l'abbaye de Wauthier-Braine, et qu'il ne pouvait la garder que pendant sa vie.
Le Ri du Charron (Ruisseau de la Fontaine de Quinchon, 1698), que l'on nomme aussi Ri des Etangs du Curé, prend sa source, près du Rond-Bosquet, à la fontaine Saint-Quinchon, sur la lisière du bois Bougni ; reçoit le Ri du Longbrou (r. g.) ; passe à peu de distance de l'église ; et se réunit au Hain (r. g.), après un parcours de 1,200 m. dans la direction du S. au N.
Le Ri du Longbrou (Ruisseau de la Boignée, 1698) vient de Braine-le-Château et se réunit au Ri du Charron (r. g.), après un parcours de 100 m. dans la direction de l'O.-S.-O. à l'E.-N.-E.
Le Ri al Mâle (Ruisseau del Gloriette?), qui porte aussi le nom de Ri de la Bruyère, prend sa source à la fontaine de Colipain ; coule à la lisière du bois du Voi-lard, d'où sortent, plusieurs petits affluents (r. dr.), en longeant le hameau de la Basse-Noucelle ; traverse la route de Tubise à Waterloo ; et se réunit au Hain (r. dr.), près de la maison du Tri, après un parcours de 1,600 m. dans la direction du N. au S.
Le Béguin prend sa source, près de l'ancienne abbaye de Nizelle, à une fontaine (la Fontaine du Chêne usé, voir plus haut) qui émerge sous une voûte et qui est précédée d'un escalier de plusieurs marches ; la tradition prétend que des expériences ont prouvé l'existence d'une communication souterraine entre cette fontaine et le puits du prieuré de Bois-Seigneur-Isaac. Le Béguin passe près de la ferme du Rosoir ; reçoit le Ri de Hautmont (r. dr.) ; suit la lisière du bois de Noucelle ; et se réunit au Hain (r. g.), en amont de la filature Taminiaux, après un parcours de 2,400 m. dans la direction du S. au N.
Le Ri de Hautmont prend sa source dans le bois de Noucelle, à peu de distance du hameau de Hautmont qui appartient à Braine-l’Alleu ; il se réunit au Béguin (r. dr.), en aval de la ferme du Rosoir, après un parcours de 900 m. dans la direction du S.-E. au N.-O.
Le Ri des Vervois vient d'Ophain et sert un instant de limite entre Wauthier-Braine et Braine-l'Alleu, pour passer ensuite à celte dernière commune ; son cours, dirigé du S. au N., n'a que 150 m.
Les principales fontaines sont celles du Bouquet, du Voilard, du Bois des Pauvres, de la Haute-Noucelle, du Champ à la Chapelle, de Saint-Quinchon (Fontaine du Quinchon, 1598), du Sacrement et du Flâchaux.
On comptait en 1784, dans la commune, 634 habitants : 1 prêtre, 2 religieux, 21 religieuses, 128 hommes, 133 femmes, 104 garçons et 87 filles âgés de plus de 12 ans, 87 garçons et 74 filles âgés de moins de 12 ans (dans la paroisse, 632 personnes : 1 prêtre, 2 religieux, 21 religieuses, 230 hommes, 220 femmes, 87 garçons et 71 filles âgés de moins de 12 ans) ; en l'an XIII, 728 habitants ; au 31 décembre 1831, 1,041 habitants; au 31 décembre 1856, 1,533 habitants.
La commune de Wauthier-Braine est placée à l'extrême limite de la région wallonne de la Belgique.
Les registres de l'état-civil remontent à l'année 1605.
Malgré les progrès que l'agriculture a faits de nos jours, une partie notable du territoire est encore boisée, comme autrefois. Les bois comprennent environ 285 hectares, formant les Bois de Noucelle (qui se nomme aussi Bois Larmont, Bois de Boularmont et dans sa partie méridionale, Bois de Hautmont), du Voilard ou du Duc d'Arenberg, Saint-Joseph ou Bougni. Presque tous les bois de Wauthier-Braine appartenaient jadis à des maisons religieuses : l'abbaye de Wauthier-Braine en avait 56 bonniers 1 journal ; Bois-Seigneur-lsaac 92 b., en partie plantés de sapins ; Ni-zelle 100 b., formant le Bois du Moulin, d'une étendue de 16b. et aujourd'hui défriché ; le Trou al Vache, couvrant 18 b. ; les Boignées. comprenant 14 b. ; les bois dits Carette, Viviers-Saint-Bernard et Croix de Boneffe, contenant ensemble 50 b. 3 journaux ; enfin il y avait encore à Noucelle une bruyère de 60 bonniers, qui appartenait en partie au seigneur du lieu, en partie à celui de Braine, et les habitants possédaient de grands terrains qu'ils laissaient en friche afin de pouvoir y envoyer leurs bestiaux.
C'est aux corporations monastiques que l'on doit la formation ou l'agrandissement de presque toutes les fermes importantes, dont actuellement les principales sont : la Court-au-Bois (76 hect.), tenue par MM. Lisart frères, appartenant, ainsi que la suivante, au général Jacqueminot ; la Ferme del Borre (64 hect.), tenue par M. Ballant (P.-J.) ; la Ferme de Nizelle (61 hect.), tenue par M. Seutin (C.), appartenant à Me Antoinette de Stockhem, de Liège ; la Ferme Jourez (55 hect.), tenue par M. Jourez (J.) propriétaire ; le Rosoir (50 hect.), tenue par M. Verbeyst (J.-B.), appartenant au comte Coghen ; la Ferme de Hardichamp (50 hect..), tenue par les enfants Duchesne, appartenant au général Jacqueminot.
Elles étaient jadis la propriété : la première, de l'abbaye de Wauthier-Braine; la deuxième et la sixième, de Bois-Seigneur-Isaac; la troisième et la cinquième, de Nizelle; la quatrième est moderne.
Le nombre des animaux domestiques constaté à Wauthier-Braine par les recensements généraux s'élevait à:
 Les terres exploitées par les cultivateurs de la commune se répartissaient ainsi :
Les terres exploitées par les cultivateurs de la commune se répartissaient ainsi :

Ce chiffre total se subdivisait en biens exploités :

En moyenne l'hectare de terre était estimé à:

L'ancienne verge linéaire a 16 1/2 pieds de Nivelles.
Deux moulins à grains sont établis sur le Hain et sont mus chacun par une roue hydraulique : le Moulin de l'Abbaye n'a que 2 paires de meules, le Moulin Linard en a 4.
Par suite de la vente de la seigneurie de Wauthier-Braine à l'abbaye de ce nom, le moulin contigu à celle-ci devint la propriété des religieuses. Dans une charte spéciale, Watier de Braine déclara, en 1280, «que tous les manants et habitants de la paroisse, avouerie, Baniche haie etc. » devraient venir y moudre comme auparavant et sous peine d'encourir les amendes habituelles. Le duc Jean Ier ayant regardé ce droit comme excessif, une enquête fut faite par les soins du bailli Jean de la Ramée, de Henri Lodart de Genappe, remplaçant le receveur du duché, et de quelques vassaux que le bailli convoqua à cet effet. Leur avis unanime fut que le droit de l'abbaye était formel, ainsi que l'avait déjà établi une enquête précédente, mais les produits de la Banisse haie furent attribués au duc (décembre 1283). Un différend s'étant élevé entre l'abbaye et les habitants du village au sujet de la capacité du « boistiau pollinois », ils convinrent de l'envoyer à Bruxelles, à Jean Robich, «juré sermenté de toutes mesures», qui renouvela cette mesure, dont la capacité fut fixée, le 12 avril 1467, à 3 1/2 wallepots, mesure de vin.
Du temps du duc Henri III, on avait voulu forcer les sujets du chapitre de Nivelles à Noucelle à aller moudre au moulin de Mont-Saint-Pont ; plus tard, l'abbesse de Wauthier-Braine, se basant sur la charte précitée de l'an 1280, obtint du conseil de Brabant un jugement qui les obligeait à reconnaître la banalité de son moulin (10 octobre 1623), et les habitants de Noucelle ayant arraché les affiches posées à celle occasion et annoncé l'intention de contrevenir à la sentence, l'autorisation de les contraindre à y obéir fut donnée aux maire et échevins du village (6 novembre 1623). Le moulin abbatial fut réparé en 1775 et vendu, le 3 pluviôse an V et moyennant 9,300 livres, à George-Joseph Demierbe, ancien récollet.
L'autorisation de construire un moulin à eau sur un terrain dépendant du fief de Bourlamont fut accordée aux religieux de Bois-Seigneur-lsaac, le 14 mai 1574, à la condition de payer au domaine 3 livres d'Artois par an. Ils pouvaient y faire moudre leurs propres grains et ceux des personnes non sujettes à banalité.
Deux filatures de coton emploient aussi le Hain comme force motrice. La filature de la veuve J.-B. De Hase (autorisée en 1826), aujourd'hui de Gustave De Hase, qui occupe les bâtiments de l'ancienne abbaye de Wauthier-Braine, est exploitée par MM. J.-J. Lambert et Cie ; indépendamment d'une roue hydraulique de la force de 10 chevaux, elle a une machine à vapeur de 20 chevaux qui commande 5,250 broches ; le nombre des ouvriers est de 80, la production annuelle de 110,000 kil. La filature de la veuve J.-J. Debacker, autorisée le 7 juin 1849, s'élève sur l'emplacement où Mme Leclercq, née Wayez, avait établi une papeterie, en vertu d'une autorisation en date du 5 juillet 1838 ; elle est exploitée par M. Jos. Taminiaux. Outre une roue hydraulique de la force de 3 chevaux, l'établissement possède une machine à vapeur de 10 chevaux ; on y compte 3,700 broches; les ouvriers sont au nombre de 60 ; la production annuelle s'élève à 75,000 kil.
Beaucoup d'ouvriers maçons quittent Ja commune pendant l'été.
La route provinciale de Tubise à Waterloo traverse le territoire de la commune sur 2,200 mètres. On compte 31 chemins vicinaux et 40 sentiers, mesurant ensemble 42,093 mètres, dont 3,700 m. étaient pavés au 31 décembre 1859. Quatre ponts sont établis sur ces chemins.
Nous rappellerons ici l'existence à Wauthier-Braine d'une localité nommée au Tomboit.
Le village ne commence à figurer dans l'histoire qu'après la fondation, vers l'année 1230, d'une abbaye de femmes, de l'ordre de Cîteaux, à proximité de l'église paroissiale. Le 24 juin 1479, le chevalier Jacques de Glymes, bailli du Brabant wallon, fit arrêter à Wauthier-Braine et enfermer au château de Genappe le charpentier P. Woultre Wynantssoen. Celui-ci, ayant fait valoir sa qualité de bourgeois de Bruxelles, fut emmené dans cette ville, dont les magistrats le firent conduire par deux sergents de l'amman au lieu où on l'avait constitué prisonnier. Là on demanda qu'il fût admis à présenter ses réclamations en justice et on l'envoya préalablement au ferme (en prison). Le lendemain, 11 juillet 1480, il parut devant les échevins du village, fit connaître les circonstances qui précèdent, et déclara prendre à partie l'auteur de son arrestation. Le lieutenant bailli fut sommé, à plusieurs reprises, de faire connaître les motifs de cette arrestation, mais personne ne comparut en son nom. Les échevins, n'osant prendre sur eux de décider une question aussi grave, se déclarèrent insuffisamment instruits, et allèrent à chef de sens au conseil de Brabant. Ce corps, après un examen minutieux du procès, ordonna la mise en liberté de Woultre (21 août 1480), qui s'était peut-être compromis dans quelque affaire politique.
Cette époque de troubles fut calamiteuse pour Wauthier-Braine, qui, en 1492, obtint une remise de 5 livres 16 sous sur sa cote dans l'aide, à raison de la pauvreté des habitants et des incendies dont ils avaient souffert. Les actes du temps font fréquemment mention de maisons ruinées ou abandonnées. A cette époque, l'abbaye adopta l'usage de se choisir un avoué ou défenseur, et elle désigna, pour remplir ces fonctions, les seigneurs de Gaesbeek et Braine-le-Château, dont les domaines touchaient aux siens. Philippe de Hornes fut revêtu par elle de ce titre, qu'elle accorda ensuite, mais seulement à titre viager, à Maximilien, petit-fils de Philippe (3 avril 1505).
Un malheureux journalier, Jean le Semette, âgé de 72 à 80 ans, s'étant tué en tombant dans une fosse à marne, le maire de la Hulpe réclama son corps « pour en faire à sa volonté », comme étant celui d'un suicidé. Mais on s'y opposa au nom de l'abbesse et de l'avoué de Wauthier-Braine ; on représenta aux échevins que le défunt n'était ni meurtrier, ni larron, ni incendiaire, seuls cas pour lesquels un criminel devait être remis aux officiers du souverain ; mais que c'était un homme de bonne vie, ainsi qu'une enquête l'avait établi ; qu'il remplissait ses devoirs de chrétien et jeûnait d'habitude tous les jours du carême ; que sa mort était le résultat d'un accident, comme cela résultait de la visite qu'on avait faite du corps; que si on avait averti le maire, ç'avait été afin de sauvegarder les droits de prince. Les échevins, se prononçant dans le même sens, décidèrent que Semette serait enseveli en terre sainte, sauf l'agrément du maire (23 février 1496-1497).
Un nouvel incident judiciaire se présenta quelques années après. Un nommé Jean Daman fut poursuivi par ordre du bailli du Brabant wallon et du maire de La Hulpe, sous l'inculpation d'avoir volé des grains dans la grange de l'abbaye de Nizelle. Daman se présenta au maire du seigneur de Gaesbeek, avoué de Wauthier-Braine, et demanda lui-même une enquête. Celle-ci eut lieu et mit en évidence son innocence, qui fut solennellement constatée par une sentence de l'échevinage de Wauthier-Braine, le 24 mai 1514.
Les limites des dîmes de Wauthier-Braine et d'Ohain sont détaillées dans un acte en date du 6 mai 1596. Un premier procès-verbal de délimitation de la commune date du 9 mars 1807 ; un second, du 20 mars 1813, en décrit les limites vers la forêt impériale de Soigne, Hal, Braine-le-Château, Haut-Ittre, Ophain et Braine-l'Alleu.
Selon les Comptes du bailli du Brabant wallon pour l'année 1403-1404, Wauthier-Braine, qui dépendait de la mairie de La Hulpe, était partagé en plusieurs juridictions, ayant chacune une législation différente : la paroisse appartenait en entier au duc de Brabant, sous lequel « toutes les amendes et forfaitures se jugeaient selon la loi de Genappe ». Toutefois le darnoisel de Gaesbeek et le chapitre de Nivelles y avaient « court et jugeurs, cens et rentes tant seulement», et la cour du premier allait à chef de sens à Liège et celle des chanoines à Nivelles. Ce que le registre cité plus haut ne dit pas, c'est que l'abbaye de Wauthier-Braine nommait également un échevinage particulier, dont la coutume d'Uccle réglait les décisions.
Les comtes de Hainaut, qui étaient princes souverains à Braine-le-Château et Haut-Ittre, d'un côté, à Longue-Rue, de l'autre coté, essayèrent d'étendre leur autorité sur une partie de Wauthier-Braine, mais ils reconnurent, en 1334, le peu de fondement de leurs prétentions, comme nous le dirons à propos de Braine-le-Château.
Une circonstance de nature à les encourager dans leurs tentatives, naissait des relations de familles existantes entre les seigneurs de l'endroit, les de Braine, et une lignée dont la résidence se trouvait en Hainaut, les d'Enghien, dont les armoiries se retrouvaient sur l'écusson des de Braine.
Dans l'état imparfait de nos connaissances sur l'histoire ancienne des familles nobles du pays, il serait impossible de dire si des liens de parenté unissaient les chevaliers du nom de Braine que l'on trouve cités dans les chroniques et les diplômes : Herlus et Abbo (ou Eppo, en 1117), mentionnes en 1093 : Henri, qui vivait en 1117 ; Henri et Guillaume, qualifiés par Giselbert du titre de conseillers du comte de Hainaut, Baudouin (Guillaume figure dans une charte, en 1164) ; Gilles, fils d'Ermengarde, dont parle l'obituaire de l'église de Soignies ; Antoine, seigneur de Gamerages, en 1200 etc. Le premier de Braine que nous trouvions en possession de Wauthier-Braine se nommait Henri, fils d'Egide. Il renonça à tous ses droits sur une dîme que l'abbaye de Cambron y tenait de lui en fief, ce que Engelbert, sire d'Enghien, confirma par une charte datée de Rebecq, le dimanche après les octaves de l'Epiphanie en 1230-1231. Dès le mois de novembre 1218, l'évêque de Cambrai, Jean, avait aussi approuvé cette cession, mais en stipulant que la personne (ou curé) du village, l'archidiacre Jean, fils de Jean, jadis médecin (physicus) du pape Innocent III, aurait le droit de reprendre celle dîme en remboursant au monastère l'argent qui avait été payé pour cet objet au chevalier.
Le remboursement ne s'effectua pas: du moins, Cambron resta en possession de sa dîme jusqu'en 1423, que les religieux l'échangèrent, ainsi qu'un cens de 34 deniers de Louvain, contre des biens d'une valeur de 17 livres, que les religieuses de Wauthier-Braine possédaient à Hérimelz.
Trois frères, nommés Walter, Siger et Jacques de Braine, fils d'une dame Marie, et probablement descendants d'Egide précité, aliénèrent le patrimoine de leur famille. La veille de Noël, en 1280, ils approuvèrent toutes les acquisitions qu'avait faites dans leurs domaines l'abbaye de Wauthier-Braine, fondée dans leur alleu, à la seule condition de leur payer 12 deniers de Louvain par an. De plus, pour satisfaire au dernier vœu de leur mère mourante, ils abandonnèrent aux religieuses le revenu du moulin contigu au monastère, en stipulant que les habitants du village seraient tenus d'y aller moudre, comme par le passé. Plusieurs de leurs vassaux et de leurs alleutiers, deux vassaux du duc de Brabant, René de Bourlamont et Egide de Hondressot (Hondzocht?), six échevins de Wauthier-Braine, deux de Lembecq, le chevalier Etienne d'Ittre et des moines de Cambron sanctionnèrent par leur présence cette importante concession.
Mais elle était contraire à un principe de droit introduit par le duc Jean Ier. Ce prince, mécontent, sans doute, de l'accroissement continuel des biens ecclésiastiques, et voulant imiter ce qui se pratiquait en France, avait interdit « d'adhériter aucune église en Brabant sans son congé spécial ». C'est pourquoi les trois frères de Braine résolurent de transporter leurs biens à un tiers à Simon Tondeurlent, de Wauthier-Braine. Ils se rendirent à l'endroit. « où on adhéritait des alleux en Brabant », et là, après avoir fait solennellement abandon de leurs droits, ils firent rédiger une charte, que sire Walter scella de son sceau, et que le chevalier Walter li Struve munit également du sien, à la demande de Siger et de Jacques, qui n'en avaient pas (samedi avant l'Epiphanie, en janvier 1280-1281).
Cependant le consentement de Jean 1er ne tarda pas à être obtenu, sans doute à prix d'argent. Ce prince délégua Jean Prochiaen pour transférer à l'abbaye sa nouvelle acquisition. Toutefois il déclara retenir à Wauthier-Braine la haute-justice, c'est-à-dire le jugement des questions de feu (ou d'incendie), de laron, de mordreur (ou de meurtrier), de truef (ou trêves), de raier ; mais « li sang, li burine (les coups et rixes) et ce dont les échevins jugent et autres menues choses qui à ce appartiennent », furent reconnues être du ressort de l'abbaye, c'est-à-dire que la décision en était dévolue à ses échevins (mardi avant Pâques fleuries, en 1230-1281). La charte par laquelle le chevalier Watiers de Braine déclara, le dimanche après la Purification, 1280-1281, que les « tréfons et les sièges et entreclos de l'abbaye et le siège de son moulin » étaient situés dans son franc alleu , que l'abbaye les tenait de lui moyennant un cens de 6 deniers de Louvain, et que lui et ses héritiers devaient y avoir toute justice, haute et basse, avait pour but d'établir nettement que l'abbaye ne tenait des Braine aucune juridiction.
Plus lard, Walter, se qualifiant seigneur de Gamerages, garantit le monastère contre les réclamations que pouvait élever au sujet de cette vente sa sœur Marie, fille de « noble homme, monseigneur Jean de Gavre » (un second époux de leur mère, sans doute). II promit qu'elle ratifierait la cession de Wauthier-Braine, et qu'il garantirait le couvent de tout dommage, sous peine d'une amende de 100 livres tournois. Cet arrangement, après avoir été arrêté « devant les hommes du duc, devant la chapelle du duc à Bruxelles», fut sanctionné par une charte du chevalier, en date du mercredi après les octaves des saints Pierre et Paul, en 1287.
Dans la suite, Gilles de Braine voulut en contester les dispositions, mais Etienne, sire d'Ittre, et Jean, son frère, choisis pour arbitres, ayant repoussé ses prétentions, il y renonça par-devant plusieurs échevins et devant des vassaux du duché, notamment René de Bourlamont, qui, à la demande des deux frères d'Ittre, scella avec eux leur décision, le dimanche avant la fête de Notre-Dame, au mois de septembre 1300.
Depuis celte époque, les souverains de Brabant eurent à Wauthier-Braine une seigneurie, qui fut comprise, au XVIIe siècle, dans l'engagère du domaine de Nivelles au baron de Bornival. Ils y instituaient un maire et un échevinage, que l'on nommait la Court du duc. Suivant les Comptes du maire de LaHulpe pour les années 1613 à 1620, leur domaine commençait « à « la maison de brique qui de tout temps a été tenue pour la prison de leurs altesses, pour servir au mayeur de La Hulpe, et suivait un ruisseau qui monte vers les bois de l'abbaye de Nizelle et va jusqu'à un autre ruisseau qui passe près de la cense du Rosoit, allant finir à la rivière de Wauthier-Braine, près de Noucelle ». Les adhéritances et des héritances s'y passaient devant le receveur du domaine à Braine. Le cens seigneurial y consistait, en 1403-1404, en 21 sous 4 deniers de Louvain, payables à la Saint-Remi, 2 sous 7 deniers payables à la Noël, 24 sous 9 deniers payables à la Saint-Jean-Baptiste, 8 sous 3 deniers de gros, dus par la «cambe brasseresse» ou brasserie, laquelle, en 1741, était ruinée depuis longtemps. La chasse et la pèche y étaient anciennement affermées au monastère voisin, moyennant 4 deniers ; en 1780, les religieux de Nizelle tenaient la chasse en location. Au XV8 siècle, les ducs de Brabant recevaient une poule, tous les ans, de quelques maisons du village, mais cette taxe cessa de se percevoir.
Dans une autre partie du village, l'abbaye de Wauthier-Braine prétendait juger, par son maire et ses échevins, assistés de sergents, les cas criminels, civils et autres, les actions tant réelles que personnelles ; elle y réclamait les amendes et forfaitures, et croyait n'être tenue qu'à livrer au maire de La Hulpe les coupables condamnés à mort. Mais les officiers du duc ne lui reconnaissaient pas une juridiction aussi étendue. Le 1er février 1047, l'abbesse fut sommée de spécifier l'étendue de ses droits.
A Noucelle le chapitre de Nivelles avait une seigneurie avec un livre censal, lequel, en 1787, valait 26 florins, et le droit de chasse (affermé à celle époque 10 florins). Il y possédait la moyenne et la basse justice ; quant à la haute, elle fut cédée par le souverain à Henri de Witlhem, en 1489, et depuis elle resta annexée à la terre de Braine-l'Alleu.
Les sires de Gaesbeek et d'Aa réclamaient quelques droits à Noucelle, sans doute comme représentants communs des premiers sires d'Aa.
En février 1303-1304, Gérard, sire de Hornes, et Jeanne de Louvain, sa femme, de la famille de Gaesbeek, vendirent un fief à Noucelle, consistant en terres, prés, bois, maisons, cens, rentes etc., et ayant appartenu à H. de la Motte. La cour ou échevinage du seigneur de Gaesbeek « souloit aller à sens à Liège », mais, après le traité de paix conclu entre Charles le Téméraire et les Liégeois, elle prit son recours habituel au conseil de Brabant. Au commencement du XVe siècle, elle reconnaissait pour seigneur le damoisel de Gaesbeek, Jacques d'Abcoude, dont le père l'avait hérité avec Braine-le-Château des Hornes, auxquels l'un et l'autre bien retournèrent après lui. De là une erreur plaisante de Blondeau, qui parle à ce propos des « demoiselles » de Gaesbeek.
Les sires d'Aa n'avaient à Noucelle que le tiers dans les revenus des « wastines» ou terres incultes, dont la propriété appartenait au chapitre de Nivelles. C'est ce que reconnut le chevalier Léon d'Aa, le lundi avant la fêle de Saint-Luc, en 1296. Ils ne pouvaient, de plus, réclamer qu'un tiers des amendes dans celte seigneurie; les deux autres tiers revenaient de droit au même chapitre, comme l'attestèrent « les échevins de la court de Nousselle sous le chapitre», après avoir consulté leurs chefs de sens, les échevins de Nivelles (acte daté de la Saint-Remi 1438). Le 2 mai 1477, Marie de Grimberghe ou d'Aa et son mari, Jean Vanden Daele, vendirent à Henri de Witthem la haute avouerie de Noucelle, avec tous les droits qui y étaient annexés ; le tout était tenu du duché de Brabant, en franc alleu.
Les échevins de Wauthier-Braine et ceux de Noucelle passaient les actes en forme de chirographes et se servaient de la langue française, dès l'année 1335.
La communauté des habitants et l'abbaye eurent souvent des contestations à propos de la quote-part de cette dernière dans l'impôt. Les religieuses réclamèrent, entre autres, contre la cotisation imposée au moulin abbatial, en prétendant que le droit de mouture ne s'y élevait qu'au 20e, au lieu de 12e ou 16e, taux ordinaire de ce droit, et qu'il produisait à peine de quoi entretenir l'usine. Le conseil de Brabant ne leur donna gain de cause qu'en partie. Le monastère resta cotisable, pour les charges réelles, selon les bases arrêtées en 1686 ; pour les aides des quartiers et des domiciliaires (ou domiciliés), sa cote fut réduite au tiers de la cote antérieure (11 novembre 1755).
En 1593, la loi du village vendit une parcelle de biens communaux « au-dessous la Longue-Bruwière », au prieuré de Bois-Seigneur-Isaac, en échange d'une cloche ; et, le 18 mars 1661, elle engagea aux religieuses de Wauthier-Braine le Vieux Chemin, joignant le Vroimpré.
Le village possédait, en 1793, 96 bonniers 2 journaux de bruyères et (pour une petite partie) de prés de la Saint-Jean. Il les a aliénés en 1812. Une fraction en était commune à tous les habitants, notamment la Bruyère du Sacrement, sur laquelle l'abbaye de Nizelle éleva des prétentions, auxquelles elle renonça le 4 décembre 1618.
Une partie des biens communaux, d'une étendue de 60 bonniers, et dont le chapitre de Nivelles était propriétaire pour les deux tiers, et l'avoué de Noucelle pour un tiers, était réservée aux habitants de Noucelle. Dans un acte du 11 janvier 1405-1406, on voit Jean, sire d'Aa et de Haulteroche (Hoogesteyn), y accorder à un particulier les aisemenls, moyennant la redevance habituelle de 2 rasières d'avoine par an. Les maire et échevins de Noucelle défendirent, le 15 février 1530-1531, d'y abattre des arbres, à l'insu du maire. Le 17 mai 1629, le chapitre de Nivelles permit à quelques particuliers d'y faire pâturer des bestiaux, moyennant une reconnaissance en avoine ; mais, plus tard, lorsque le maire et les habitants de Wauthier-Braine manifestèrent l'intention de livrer à la culture les bruyères de Noucelle, le chapitre, après avoir résolu de protester contre cette usurpation et annoncé l'intention d'opérer lui-même ce défrichement (22 octobre 1772), apprit que les habitants de Noucelle voulaient défendre en conseil de Brabant leurs droits sur leurs communes, et déclara alors n'y rien prétendre, en protestant qu'il entendait rester étranger au procès (31 octobre). Toutefois il accepta un accord qui lui fut proposé par le greffier du village. Nivelles et la dame de Braine devaient renoncer, au profit du village, aux deux tiers des communes contestées, où on leur paierait, toutefois, comme dans les autres fonds de la seigneurie de Noucelle, une redevance consistant en 4 genouillées d'avoine et un sixième de chapon, par bonnier(16 décembre).
Wauthier-Braine fut compris, en l'an III, dans le canton de Braine-l'Alleu, puis, en l'an X, dans le deuxième arrondissement de justice de paix de Nivelles.
Le budget de la commune, pour 1859, présente les chiffres suivants :

Outre les seigneuries qui se partageaient la juridiction à Wauthier-Braine, il y existait quelques grands fiefs dont les abbayes du voisinage acquirent successivement la propriété. René de Bourlamont, dont nous avons déjà cité le nom, y tenait en fief du duché de Brabant la Tour de Bourlamont, avec 4 bonniers de terres. Ce René portait dans son sceau un cavalier armé et casqué, ayant au bras son écusson, et sur sa robe une reproduction de ses armoiries, qui étaient vairées de quatre rangées de pièces, posées comme suit : 12,10, 8, 2, et portaient en chef, un lion issant. En légende on lisait : S. SEGNEUR DE BOURLAMON CHER (chevalier). Le contrescel reproduisait ces mots et les armoiries du chevalier.
Par une charte donnée à Bonchefort (ou Boitsfort), le dimanche après la mi-carême en 1299 (1300 nouveau style), le duc Jean II déclara donner la maison de Bourlamont et des biens à Ohain, en ne s'y réservant que la haute justice, à Pierre de Braine, receveur do son oncle Godefroid de Brabant, sire de Vierson, pour en jouir après le décès de Buene Bonsart de BIocu, à qui il en avait fait abandon, à titre viager. Cependant René vivait encore en 1309. En 1312, c'était Arnoul du Mesnil qui possédait son fief à Braine-l'Alleu.
Les du Mesnil prirent alors le nom de Bourlamont. et leurs fiefs à Braine-l'Alleu et à Wauthier-Braine eurent successivement pour maîtres :
Arnoul de Bourlamont ;
Jean, fils de sire Guillaume de Bourlamont (vers 1 350), et dont les sœurs, Marguerite et Catherine, donnèrent en location, le 6 mars 1365-1367, leur ferme de Huysinghen ;
Claiskin (le petit Nicolas) Den Hertoge, neveu de Jean, et encore mineur (relief de 1384-1385) ;
Robert Vanden Bossche ou Dou Bos, dit Griseteste, autre neveu de Jean (r. de 1385-1386), vendit le Mesni l;
Etienne Van Luystaul (de Luttéal), après la mort de Robert (r. du 7 mai 1418) ;
Henri Herlewyc, par achat (r. du 10 décembre 1422) ;
Jean, sire de Wesemael, en vertu de lettres échevinales de Louvain. Ce dernier vendit Bourlamont, avec la tour, les viviers, les eaux, les terres, les wastines etc., qui y étaient annexés, à Jean Vander Straete ou de Lyra, chanoine de Nivelles, d'Anderlecht, de Liège et de Cambrai, qui en fit don au prieuré de Sept-Fontaines (15 janvier 1444-1445). Plus tard, ce dernier établissement céda ses droits aux religieux de Bois-Seigneur-Isaac (1470), qui en avaient déjà obtenu d'autres en vertu du teslament de l'abbesse de Nivelles, Christine de Frankenberg, et qui y réunirent encore, le 29 décembre 1470, ceux que cette abbesse avait légués à l'abbaye de Wauthier-Braine. La tour de Bourlamont tomba en ruines et son nom aurait été voué à l'oubli, sans le moulin à eau que les religieux élevèrent à proximité, en 1574, le moulin Linard actuel. La tour était longée, vers le midi, par le chemin conduisant de Braine-l’Alleu à Wauthier-Braine.
Les fermes Del Borre, Hardichamps et Vanderkelen appartenaient également au prieuré de Bois-Seigneur-lsaac. La première comprenait 67 bonniers de terres et 16 b. de prés, la deuxième 36 b. de terres et 3 b. de prés, et la troisième 22 b. de terres et 2 b. de prés, en sorte qu'y compris 3 étangs, 92 bonniers de bois, et quelques autres propriétés, le prieuré était propriétaire de près de 250 bonniers, à Wauthier-Braine. Del Borre et Hardichamps furent vendues, le 29 frimaire an V, à Paulée, de Paris, la première, pour 26,200 livres, la seconde, pour 18,600 livres ; et Vanderkelen, le 26 du même mois, à Jeanne-Josèphe Lambrechts et Marguerite Jacquet, religieuses du couvent de Saint-Victor, à Huy, moyennant 11,000 livres.
Au sud du Hain c'était l'abbaye, de Nizelle qui était en possession de presque tout le territoire. La ferme du Rosoir, après avoir été vendue par Roland de Bornival à Jean d'Yssçhe, écolâtre de Bruxelles (15 octobre 1395), fut cédée par ce dernier à sa fille Marie et à son mari Gilles le Clivre ou De Clivere. Marie était devenue la femme de Jean de Robersart, lorsque, du consentement de Jean, son frère, elle vendit Rosoir à Guillaume d'Assche, prévôt de Saint-Pierre à Louvain (18 juin 1437). L'abbesse de Nivelles l'acquit de celui-ci, le 8 août 1439, et en dota le monastère qu'elle fonda alors à Nizelle.
Nous avons dit, à l'article Ophain, qu'un hameau existait à l'endroit où s'éleva cette abbaye. La cense de Haute-Nizelle, qui était tenue en fief de l'abbaye de .Wauthier-Braine, appartint successivement à messire Robert de Limelette, puis à Jean de Limelette. Celui-ci, en 1450, la céda avec 15 bonniers déterres et 5 b. de prés et de bois, à Désir Baudehier, moyennant 4 muids de blé par an. Gérard Dau, de Nivelles, la vendit, en 1457, au monastère de Nizelle, qui acquit de Piérart Bertrand, dit Gossiaco, en 1473, la seigneurie foncière qu'avait eue en cet endroit Costin de Limelette, fils de Jean précité, et qui consistait en un cens de 10 chapons, 3 vieux gros, 8 sous .4 deniers oboles de Louvain, 4 bonniers de bois dit le Bois Arnoul, un maire « pour cacher ses cens et rentes », droit d'entrée et d'issue, et une cour féodale de quatre hommages.
La maison qu'Orival possédait à Haute-Nizelle, et que Gilchon Baudehier tenait à cens pour un terme de 95 ans, devint, en 1470, la propriété de l'abbaye de Wauthier-Braine ; puis, en juillet 1518, celle des religieux de Nizelle. Cette habitation était alors ruinée «par fortune de guerre». Les religieux achetèrent aussi, le 7 juillet 1483, moyennant 260 peters de 54 placques, de la famille Le Hongre, la cense le Houssoit, avec 21 bonniers de terres, 3 1/2 b. de prés, 6 b. de bois et de bruyères et 2 maisons.
Toutes ces acquisitions soulevèrent entre les deux abbayes quelques débats qui furent terminés par un accord en date du 13 décembre 1498. Nizelle aurait dû constituer plusieurs « lais-vestis » pour les terrains dont les religieux étaient devenus propriétaires ; Wauthier-Braine déclara se contenter d'un seul. Cette congrégation confirma à sa voisine le droit que les seigneurs de Nizelle et du Rosoir avaient sur leurs terres d'y « prendre conins (ou lapins), lièvres et autres bêtes et sneppes ou oiseaux ». De son côté Nizelle paya une indemnité de 34 peters et reconnut que la ferme de Haute-Nizelle, qui était tenue par un frère lai, était assujettie à moudre ses grains au moulin de Wauthier-Braine. Lorsque l'abbaye de ce village concéda à Nizelle les bruyères des Haulxmons, à charge d'un muid de blé, par an, les religieux furent autorisés à chasser dans toutes leurs possessions a Wauthier-Braine et exemptés de l'obligation de se faire représenter par un lai-vesti (7 octobre 1504).
En 1773, ces possessions comprenaient, outre la ferme de l'abbaye, celle du Rosoir, avec 60 bonniers de terres, louée 390 florins ; 100 b. de bois, dont le revenu était évalué 1,000 florins ; 2 1/2 b. d’étangs. La ferme abbatiale, reconstruite en 1784 et affermée à cette époque par le gouvernement autrichien sous le nom de Haute-Nizelle, a été vendue, avec 65 bonniers de terres et 7 b. de prés, pour la somme de 140,000 livres. Elle n'offre rien de remarquable, sauf que, dans le mur d'une grange, on voit une pierre avec la devise : Quæ sursum sunt ; près de la grande entrée, on remarque une petite porte, surmontée d'une ogive obtuse.
L'église paroissiale, dont Saint-Pierre et Saint-Paul sont les patrons, a successivement fait partie du doyenné de Hal, dans l'évêché de Cambrai ; après 1559, du doyenné de Nivelles, dans l'évêché de Namur ; et, à la suite du concordat, de l'archevêché de Malines, où elle prit rang parmi les succursales de l'église de Braine-l'Alleu.
C'était une église entière, et elle constituait un personnat, dont les biens furent réunis à la cure, en 1629 ; la collation de celle-ci fut alors attribuée au chef du diocèse. Le curé y percevait un tiers de la grande dîme (les deux autres tiers appartenaient à l'abbave du lieu) et une part dans la dîme des foins; il levait aussi la dîme entière de ce que l'on appelait le rondeau de la procession du Saint-Sacrement, la menue dîme, les novales etc. 11 possédait 16 bonniers 1 journal de terres, 13 journaux de prés, 1 bonnier de bois, et de plus, en vertu d'une sentence rendue en l'abbaye de Wauthier-Braine, en 1463, par des docteurs en droit de Louvain, et modifiée ensuite par une transaction, le 9 décembre 1638, la moitié des biens de l'église. Le tout produisait, en 1787, un revenu de 1,493 florins 8 sous, dans lequel les dîmes figuraient pour 532 florins. Une partie des biens provenaient d'une chapellenie de Notre-Dame, qui était chargée d'une messe par semaine. Les revenus de la fabrique ne s'élevaient, qu’à 56 florins 6 sous ; ils montent aujourd'hui à 1,016 francs. Les biens de l'église consistent en 1 hectare 40 centiares.
L'église, du temps de Blondeau, était d'une architecture fort ancienne. On l'a abattue en 1831 pour la reconstruire sur les plans de l'architecte Moreau, de Nivelles. C'est un édifice en briques, de forme basilicale, à trois nefs séparées par des colonnes toscanes et comptant six travées. La grande nef est voûtée en plein cintre. Un clocher carré précède le vaisseau et supporte un clocheton revêtu d'ardoises et se terminant par une toute petite flèche quadrangulaire. Le maître autel est dédié aux saints patrons, les autels latéraux à la Vierge et à Sainte-Anne.
Il a existé, un peu au nord de l'abbaye, une chapelle dédiée à Notre-Dame de Foi, à laquelle l'évêque Engelbert Des Bois concéda 40 jours d'indulgences, et ou le successeur d'Engelbert permit, le 14 septembre 1660, d'établir un autel et de dire la messe, les dimanches et jours de fêtes exceptés. Basse-Noucelle a eu un ermitage et une chapelle dédiée à Sainte-Aldegonde. A la chapelle était annexé un bénéfice, dont la collation appartenait au chapitre de Nivelles, et dont la dotation consistait en dix bonniers de terres. Il était chargé d'une messe par semaine. En 1787, l'ermite de Noucelle, qui se nommait Paul, avait été « supprimé», mais il refusa de quitter son habitation. Le 23 pluviôse an VIII, la république française vendit celle-ci, la chapelle et ses biens à M. Vauthier, pour 2,500 francs. Aujourd'hui il n'en reste plus de trace.
L'histoire de l'abbaye de Wauthier-Braine ou de Notre-Dame de Braine, de l'ordre de Cîteaux, est très imparfaitement connue. Sanderus ne l'a pas comprise dans sa Chorographia sacra Brabanticæ, et Gramaye, Blondeau, le Guide fidèle, la Gallia christiania n'en disent que peu de chose Ce qui suit est presque entièrement emprunté à des documents originaux et restés inédits. On date parfois la fondation du monastère du 24 mai 1224 et on prétend qu'elle eut pour première abbesse Claire del Barre, qui entra d'abord comme professe au monastère de Beaupré, non loin de Grammont, avec trois sœurs, Béatrix, Ode et Ide, mourut en odeur de sainteté, en 1247, et fut remplacée par Marie de Gavre, sœur du fondateur du couvent, morte en 1272.
D'après les chartes mêmes de l'abbaye, Béatrix, Ode et Ide voulurent fonder un monastère de l'ordre de Cîteaux doté de leurs biens, à Lare (probablement l'endroit peu éloigné de Wauthier-Braine, mais sur Braine-le-Château, où exista longtemps la ferme de Lare). Elles firent don de ces biens à l'abbesse et au couvent de Beaupré, qui essayèrent d'en obtenir l'abandon complet de l'héritière de ces biens, Claire, fille de Simon de Lare, nièce des trois sœurs. Bientôt on trouva un emplacement plus convenable, mais alors aussi une contestation s'éleva entre l'abbaye et les trois sœurs. Asso, ancien chapelain du Goûtal à Nivelles, chanoine de Saint-Aubin à Namur, René, curé de Lembecq, Jean, curé de Tourneppe, les chevaliers Gérard de Bas-Tourneppe, René de Tourneppe, Hugues de Cecâ valle, Maurice de Haubruges et N. de Ransebecque, ainsi que Henri de Braine, furent acceptés pour arbitres. Les trois sœurs renoncèrent à leurs droits sur leurs biens et à la faculté d'y habiter sans le consentement de l'abbesse et du couvent; celles-ci s'engagèrent à payer leurs dettes, et notamment 30 sous, qu'elles devaient à leur neveu Henri (mars 1230-1231).
Claire, dont le père, Simon de Lare, était devenu lépreux, donna en aumône à Wede ou Ode, abbesse de Beaupré, pour le couvent de Braine-Notre-Dame, tout son fief de Rodenem (sur Hal), ce qui fut ratifié par son suzerain, le chevalier Nicolas de Naast, en 1235, et par Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, l'année suivante Egeric, chevalier de: Tourneppe, avait quelques prétentions sur les biens des trois sœurs et de Claire, et notamment sur Rodemem ; il en fit également abandon à Ode, à la suite d'urne sentence arbitrale du doyen de Hal Walter, du chanoine George et de Godescale de Braine-l'Alleu, donnée à Lare, en 1231. Le monastère s'éleva alors, près du village de Wauthier-Braine, et sous l'invocation de Notre-Dame. Béatrix avait cependant soulevé de nouvelles difficultés, ainsi qu'il résulte de la pièce suivante, dont nous donnons le texte comme un modèle de l'idiome alors usité : « A tous chiaus ki ces lettres veront, je M. abbesse de Bialpret fac savoir que dame Wede, ki Jai fu abbesse de Bialpret, dist et tesmoingne quele oi ditre que damoiselle Béatrix de le Lare et ses II sereurs Wede et Ide denerent absoluement ens la main mon segnor Asso, ki dont estoit capelains del GotalE de Nivele et oe est canoines de Tornai tout cho queles dîsoîent et creoient avoir ens le warison ki fu Simon de la Laie lor frere en fiet et en iretage, pour faire une abbie de dammes del ordene de Cistiaus, et mesures Asses del don queles fait li avoient, reporta ens la main damme Wedain. Et après cho par alcunes okisons et por le bien de pais si se remisent en mon segnor Asson par foit et par sairement, si corn en arbitre, por tenir quant quil ordeneroit. Et me sire Asse dist par arbitre que toute li warisons en fiet et iretage eusi com eles denet Iavoient demouroit al abbesse por labié faire, et les III sereurs aroient kascun au XIII muis de soile tant com eles viveroient, cest IIII mui sakascune, par tel que de kascune ki morroit, seroit li maisons quite de sa porcion. Et après cho que me sire ot cho dit, dammiselè Béatrix dist quele ne si assentoit nien, ains vorroit retenir la sienne tierce partie, et convient quil soit ensit es letres que dammisele B. dist que nos li devans li entenlions damme Wedain fu selonc forme ki chi inscrite. Ces letres furent denees lan del incarnation « M.CC.XXXVIII, lendemain de S. Berlhremeu».
Les bienfaiteurs et les protecteurs ne manquèrent pas à la nouvelle communauté. Le duc Henri Ier lui donna ses droits sur la dîme du village (charte donnée apud Bruxellam, en 1232, le jour de Saint-Jean devant la porte latine, confirmée par son fils, le premier dimanche de l'Avent, en 1235, et par Nicolas Scarfus, chanoine de Cambrai, personne de Wauthier-Braine, le jour de Sainte-Marie-Madelaine, en 1250). Par une charte datée de la veille du dimanche où l'on chante Circumdederunt me, les abbés d'Alne et de Cambron déclarèrent admettre les religieuses dans l'ordre de Cîteaux, et bientôt les souverains pontifes les dotèrent de privilèges. Sur ce qu'elles se plaignaient d'être exposées à des vexations et à des dénis de justice, le pape Grégoire IX ordonna aux supérieurs ecclésiastiques de la province de Reims de les protéger (Viterbe, le 20 octobre 1235) ; il leur confirma leurs possessions, en leur assurant les privilèges ordinaires des monastères de l'ordre de Cîteaux (27 novembre 1235), et prit spécialement sous sa protection les dîmes qu'elles avaient acquises à Wauthier-Braine et à Elinghen (15 mai 1237). Innocent IV, par trois chartes données à Lyon en 1246, les autorisa, le 23 juillet, à retenir les biens qui leur seraient laissés ou légués; les exempta, le 9 août, de tout péage pour les objets servant à leurs propres usages ; et, le 1er décembre, enjoignit à son tour de protéger la communauté et ses biens.
De nouvelles acquisitions, dont la plus importante fut celle de la seigneurie de la famille de Braine, en 1280, consolidèrent le monastère, dont l'existence se poursuivit si obscurément que l'on ne connaît pas même toutes les abbesses qui l'ont gouverné. Voici la liste de celles qui paraissent dans des actes authentiques :
Pétronille, citée en 1263 ;
Isabelle, en 1275 ;
Alice de Rode, en 1402, 1430 ;
Jeanne de Richelle, en 1448 ;
Catherine Doillies, en 1467, 1470 ;
Barbe Rolant, en 1485, 1498 ;
Anne, en 1504, 1516 ;
Catherine Charasce, en 1552 ;
Marie de Barbençon, nommée en 1561, morte à Paris en 1598 ;
Catherine de Letté,en 1570 ;
Jeanne de WVessem, en 1603 ;
Françoise Servais, en 1630 ;
Marie de Patoul, élue le 6 avril 1636, morte le 12 mars 1653 ;
Catherine Van Merstraeten, nommée le 6 juillet 1653, morte le 20 mai 1667 ;
Marie Vander Straeten, nommée le 17 septembre 1667 ;
Anne-Françoise de Mendivil, nommée le 3 juin 1688, morte le 4 mars 1714 ;
Agnès Baulez, nommée le 11 mai 1714, morte le 26 mars 1732 ;
Marie de Kessel, fille du seigneur de Watermael, nommée le 10 mai 1732, morte le 6 septembre 1755 ;
Madelaine Del Bauche, nommée le 25 octobre 1755 ;
Isabelle de Rideau, nommée en 1779, morte à Nivelles après la suppression.
Nous avons trouvé à la Bibliothèque Royale de Bruxelles une liste plus complète des abbesses, rédigée, en 1734, par le confesseur de l'abbaye, frère Constantin Del Bauche, mais comme elle fourmille d'inexactitudes, nous n'avons pu nous en servir pour combler les lacunes de la nôtre. Le monastère était assujetti à fournir par an 40 corvées, mais sa pauvreté était si grande, que, ne pouvant les obtenir, les officiers du domaine se résignèrent à y renoncer, pendant le XVe siècle.
Au XVIe siècle, une réforme fut introduite, et on appela à diriger la communauté Catherine, professe de l'Olive. L'abbesse qui lui succéda, Marie de Barbençon, fut la première supérieure nommée par le souverain. Les bâtiments, et particulièrement le moulin à eau et retordoir, ayant été incendiés, le jour de Saint-Martin, en 1576, on dépensa 1,241 livres pour les reconstruire. En 1578, les troupes espagnoles et françaises du comte de Mansfeld se répandant dans le pays, « pillant, brûlant et rosbant tout», les religieuses se dispersèrent : la plupart se rendirent en Flandre, où les maisons de l'ordre étaient encore tranquilles ; les autres, accompagnées des sœurs converses et des .serviteurs, se retirèrent, le 18 février, à Hal. Mais là de nouveaux malheurs les attendaient. Tandis que les ennemis mettaient le feu à leur cloître et enlevaient leurs cloches ; leurs chaudières et tout ce qu'elles avaient « masonné et mis en des caves », le pillage et l'incendie de Hal détruisirent une grande partie de leurs effets. Du 1er août 1578 au 1er août 1579, l'entretien des religieuses coûta 2,320 livres. Après avoir vécu huit ans, tantôt à Hal, tantôt à Braine-le-Château, la communauté se réunit de nouveau.
Sous le gouvernement des archiducs, les bâtiments furent reconstruits. En 1610, les évêques de Namur, d'Arras et de Tournai, en engageant les fidèles à contribuer à ce travail, avancent que le couvent avait été détruit par les hérétiques et rebelles, maîtres de Bruxelles, ce qui ne coïncide pas avec les faits rapportés plus haut.
Le 13 juillet 1619, le maître des forêts conclut à ce que l'abbesse fût condamnée à une amende de 60 réaux, parce que, contrairement aux édits sur la matière, elle permettait au comte de Houtekercke et à d'autres particuliers de chasser en dehors de l'époque déterminée.
Par missive en date du 12 novembre 1682, le gouverneur général, marquis de Grana, avertit l'abbesse que la visite du monastère par des supérieurs étrangers ne pouvait concerner que le spirituel ; pour le temporel, défense fut faite de leur communiquer aucun renseignement.
Dans une déclaration en date du 15 février 1694, on lit que la communauté avait payé depuis 1689, en contributions de guerre de toute espèce, 3,898 florins 7 sous, notamment 460 florins donnés à un parti de 100 hommes, qui avait voulu mettre le feu à l'abbaye, au mépris des sauvegardes accordées par les généraux français. Deux de leurs fermes, celle du Mont, à Haut-Ittre, et Resteleu, à Hal, étaient confisquées, et cette dernière détruite.
En 1755, ordre fut donné à l'abbesse d'enregistrer exactement ses recettes et ses dépenses. Un certificat du roi d'armes Jaerens, du 20 novembre de la même année, reconnut au monastère les armoiries suivantes : d'azur à la croix d'or, entourée de ses perles d'argent et couronnée d'or, l'écu surmonté d'une crosse, également d'or.
Les bâtiments tombant de vétusté, on en commença la reconstruction en 1763. Pour faire face à cette dépense et liquider quelques dettes, les religieuses furent autorisées à lever 20,000 florins (9 novembre 1763), puis encore 6,763 flor. (23 février 1785). La réédification du moulin abbatial et de l'église d'Elinghen nécessita un autre emprunt de 10,000 flor. (octroi du 30 juin 1775).
Comme histoire mystique, on ne signale rien à Wauthier-Braine, si ce n'est, suivant Raissius, l'existence d'un crucifix miraculeux. C'était l'abbé de Villers qui avait la direction de la communauté. En 1787, cette dernière se composait de 24 religieuses (nombre qui s'était anciennement élevé à 34 ou 35) et d'une novice ; il y avait en outre 2 prêtres, 2 domestiques et 3 pensionnaires. L'entretien de toutes ces personnes coûtait par an 7,760 florins, dont 7.000 pour les religieuses seules. Les dépenses s'élevaient eu tout à 8,284 flor. et les revenus à 8,834 flor. Ces revenus provenaient des biens que le monastère possédait dans le village même, à Braine-le-Château, a Haut-Ittre, à Monstreux, à Hal, à Bogaerden, à Haute-Croix etc., de ses dîmes de Wauthier-Braine et d'Elinghen, de ses livres censaux à Wauthier-Braine et aux environs, à Rodenem (sur Hal), à Brages.
Les biens de Wauthier-Braine comprenaient une seigneurie, l'enclos même du monastère, d'une étendue de 4 bonniers 1 journal ; la ferme adjacente, avec 14 b. 3 j. de terres et 9 b. de prés (outre, sous Braine-le-Château, 44 b. 2 j. de terres, 6 b. 3 j. de prés et 8 b. et 2 j. de bois), que les religieuses exploitaient elles-mêmes ; la Court-au-Bois, de laquelle dépendaient 73 b. de terres, 11 b. de prés (plus. 5 b. de terres à Braine-le-Château), louée 1,023 florins ; le moulin abbatial, qui se louait 374 florins 16 sous ; deux tiers de la grande dîme, produisant 622 florins; un bois de 56 b.1 j.
Les religieuses avaient le droit de faire pâturer leur bétail dans les bruyères et communes de Braine-le-Château ; des autorisations temporaires d'envoyer dans la forêt de Soigne 24 bêtes à cornes leur furent aussi accordées à plusieurs reprises, notamment le 27 février 1726.
En 1794, à l'arrivée des Français, l'abbaye fut entièrement pillée ; on lui imposa ensuite une contribution de 12,000 livres. Elle fut supprimée, le 6 vendémiaire an V, et on offrit des bons nationaux aux religieuses, qui, à l'exception de deux, les refusèrent. Le 7 frimaire an VI, on vendit à V. Louis Pommier les bâtiments conventuels, pour 71.000 livres. Lorsqu'on y installa une filature, en 1826, on en démolit une partie et notamment l'église. Ce qui en reste est construit en briques et couvert d'ardoises. La façade principale, tournée vers l'ouest, se compose d'un corps de logis, flanqué de deux ailes en retour, et n'ayant qu'un rez-de-chaussée et un étage. Dans le haut de cette façade, devant laquelle jaillit une gerbe d'eau, et à laquelle une grille de fer donne accès, on voit encore une horloge qui marque les secondes et indique les jours de la semaine. Des jardins clos de murs et arrosés par le Hain entourent les bâtiments, où l'activité industrielle remplace aujourd'hui la vie contemplative.
Nous avons déjà dit que le couvent de Ter-Cluysen avait commencé à Wauthier-Braine, dans un endroit où se trouvait un étang avec une motte ou monticule, près du Hain et près du chemin allant de la ferme Delorre au Vroimpret. Cet emplacement portait le nom de la Motte ou Ter Molten. Il appartint primitivement à un bourgeois de Bruxelles, nommé Guillaume Cliuting, puis à son fils Henri. La duchesse Jeanne ordonna, le jour de Saint-Thomas, en 1357, aux justiciers et échevins de Wauthier-Braine, d'en adhériter Jean de le Stienweghe, à charge de le tenir à cens du couvent de Coude Cloester ou de Sainte-Claire à Bruxelles, moyennant 20 vieux florins hellinghe de Florence. Par trois actes passés le 15 mars 1393-1394, Jean Vanden Steenweghe vendit au couvent de la Motte la maison et l'étang de ce nom, qui étaient tenus à cens du domaine ducal, le pré dit Bonart hof, bien tenu à cens de l'abbaye de Wauthier-Braine, et d'autres terres comprises dans la seigneurie du chapitre de Nivelles. Jean de Hontsot, petit-fils de Jean par Lise, sa mère, était alors hors du duché; il ratifia cette vente le 22 février 1396-1397. Après la translation du couvent à Ter-Cluyse, les bâtiments de la Motte tombèrent en ruine, et le terrain passa au prieuré de Bois-Seigneur-Isaac.
Le revenu des pauvres s'élevait en 1787 à 265 florins.
Le budget du bureau de bienfaisance, pour l'année 1859 a été fixé comme suit :

Dans ce dernier chiffre le revenu des biens (5 hect. 7 ares) figure pour 602 fr. 80 c.
On mentionne, en 1479, une maladrerie, qui se trouvait près du chemin conduisant du village à Nivelles.
Le nombre des enfants pauvres qui ont été admis par la commune, en 1858-1859, à recevoir l'instruction, s'est élevé à 153 : 69 garçons et 84 filles.
La fête communale se célèbre le quatrième dimanche de septembre; il y a en outre une fête le jour des Saints Pierre et Paul.
Le charpentier Jacques Bieselens, à qui on attribue la reconstruction de l'église de Nizelle, au XVIe siècle (qui nostram edificavit ecclesiam), habitait Noucelle. Les religieux de Nizelle lui cédèrent, le 29 août 1525, moyennant une rente de 5 florins, une maison située près de Bourlamont, à la rue conduisant de Braine-Alleu à Wauthier-Braine.

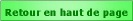
 |
Avec le soutien de la Province du Brabant Wallon |

