


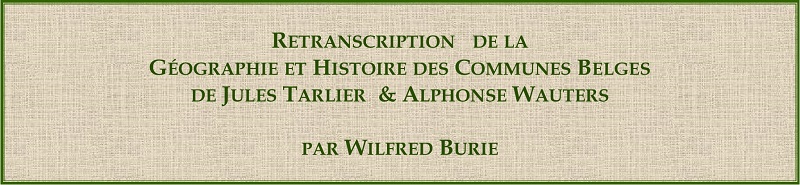
Jadis on voyait près du marché, au fond d'une espèce d'impasse, une vieille église, actuellement convertie en une boucherie, dont le mur latéral, du côté de la cour, offre encore de petites fenêtres ogivales blindées et des traces d'arcades renaissance. La façade du côté de la place, qui a subsisté jusqu'en 1822 ou 1823, offrait une statue de la Vierge et c'était là qu'on déposait les corps des morts, en attendant l'instant de l'inhumation. De là le nom de trou des mau-chaussés, qu'on donnait a cet endroit et qui vit encore dans la mémoire des Nivellois.
Cette église, dont saint Nicolas était le patron, existait déjà en l'an 1222. Depuis 1231, l'hôpital Saint-Nicolas n'y percevait plus les offrandes que pour une moitié, aux cinq grandes fêtes de l'année ; d'autre part, il fut alors exempté de payer au curé ce qu'il lui donnait antérieurement. L'échevin Wyon de Cologne y fonda en l'honneur de saint Nicolas une chapellenie, qu'il dota d'une redevance de dix muids de seigle, à charge d'une messe par semaine et d'une distribution annuelle aux pauvres de deux muids, lors de la célébration de son obit et de celui de sa femme Gertrude (14 octobre 1294). Trois années après, en 1297, Walter de Houtain, chanoine de Nivelles, institua la chapellenie de Saint-Jean-Évangéliste dite de Wathier, à la condition que le bénéficier assisterait aux heures à Saint Paul et célébrerait une messe tous les jours.
En l'année 1549, l'église de Saint-Nicolas, alors appelée de Saint-Jean-l’Evangéliste « sur l'Arbolut, joignant au marché », fut mise en ruine, et, pour la remplacer, les curé, mambours et paroissiens entreprirent la construction d'un nouveau temple, « celui de Saint-Jean-l’Evangéliste que l'on dit de Saint-Nicolas ». La ville, dit-on, abandonna à cet effet l'emplacement du Marché au bois ; de plus, les trois membres votèrent, au mois de mars 1550-1551, un subside de 12 livres de gros. Pendant les troubles de religion, l'église fut fortement endommagée, et, pour cette raison, sans doute, le curé en fit la remise au chapitre, le 2 mai 1582. Les paroissiens la firent restaurera leurs frais et lui procurèrent deux cloches et de beaux ornements. Sa circonscription s'était alors accrue delà paroisse Saint-Maurice, supprimée en 1586; en ville, elle était limitée par le Marché et la rue de Sainte-Gertrude, et comprenait toutes les maisons des rues du Wichet et de Charleroi ; au dehors, elle englobait le faubourg de Charleroi et s'étendait jusqu'au Bois de Nivelles. On y joignit encore, en 1753, la paroisse de Saint-Jean-Baptiste.
En l'année 1676 il fut question de supprimer cette église, le projet provoqua de violentes clameurs dans !a population. Aucune autre église paroissiale, fit observer le curé, n'était aussi belle, ni aussi grande ; le cimetière était vaste, et si on fermait le temple, des religieux s'empresseraient d'en acquérir la propriété. Les paroissiens observèrent qu'ils avaient bâti cet édifice à leurs propres frais et non sans de fortes dépenses ; que, depuis 32 ans, ils l'avaient, pour ainsi dire, presque reconstruit en entier, et que durant cette période, la fabrique y avait consacré, en travaux de toute espèce, 11,270 florins. Ils signalèrent, en outre, l'extrême étendue de la paroisse. Quoique le chapitre eût déclaré, le 12 novembre 1676, qu'il tenait cette église pour la plus belle et la plus commode de la ville, les trois membres crurent devoir attester, de leur côté, qu'ils la considéraient comme celle dont la conservation était la plus nécessaire (7 mai 1677).
En l'année 1787, le curé possédait un revenu de 978 florins, provenant notamment de deux cinquièmes de la dîme des curés de Nivelles. La cure qu'il occupait avait été léguée à la fabrique, le 20 août 1717, par un de ses prédécesseurs, Jean-Charles Molinvaux, et rebâtie en 1758. A l'église étaient annexés quatre bénéfices : celui de Sainte-Catherine, un cantuaire (de Saint-Nicolas?), la chapellenie de Sainte-Marie-Madeleine et une autre du même nom, respectivement chargés de 25, 56, 24 et 2 messes par an. On y érigea, le 16 novembre 1644, une confrérie de la Sainte-Trinité.
L'église de Saint-Jean-l'Evangéliste fut fermée en l'an VI, et quoiqu'elle eût été rendue au culte le 9 ventôse de cette année, on en mit la cure à la disposition d'une institutrice, le 24 germinal suivant. Le 23 frimaire an VIII, elle fut vendue, moyennant 60,000 livres, à Emm. Hariet, de Nivelles, qui n'était probablement qu'un prête-nom. Lors du concordat elle devint une des succursales de la cure de Braine-l'Alleu, avec juridiction sur une partie de la ville au sud d'une ligne allant de la porte de Mons à celle de Namur, et sur le canton de la banlieue avoisinant les remparts, de la porte de Mons à celle de Charleroi (1er juillet 1803). Supprimée en 1807, et cependant maintenue de fait, par considération pour le curé Malcorps, l'église de Saint-Nicolas redevint une succursale vers l'année 1842. En 1821, la régence proposa de modifier la circonscription des paroisses de Nivelles, qui assigne à Saint-Nicolas un territoire plus étendu que celui qui est soumis, au spirituel, à la collégiale ; ce projet avorta. De même, en 1825, l'église ne fut pas comprise au nombre des chapelles qui furent alors reconnues.
L'église de Saint-Jean-l’Evangéliste, où saint Nicolas est révéré comme patron secondaire, est un petit édifice de 33 mètres de long sur 46 de large. Elle appartient au style ogival de la dernière époque. Elle dessine une croix latine et a trois nefs ; mais les croisillons du transept sont si courts que, lorsqu'on aura élargi les collatéraux, conformément à un arrêté royal du mois de mal 1862, le plan rappellera la disposition d'une basilique.
Le chœur, éclairé de chaque côté par deux fenêtres dont l'ogive a été arrondie à l'intérieur vers 1780, se termine par une abside à trois pans. Comme le reste de l'église, il n'est recouvert que d'un plafond. Les nefs sont divisées en quatre travées (non compris le transept) par des colonnes renaissance, à base octogone, qui supportent des arcades en plein cintre probablement postiches. Chaque travée est percée à droite et à gauche, comme les croisillons, d'une fenêtre ogivale. Une arcade, également ogivale, sépare les bas-côtés du transept.
A l'extérieur, l'église est entièrement revêtue de pierres de taille blanches, sauf au soubassement qui est en pierres bleues. Le portail se trouve actuellement au pied de la croix ; il consiste en une porte carrée, fort simple et toute moderne ; antérieurement il existait deux entrées latérales à l'extrémité des collatéraux, près du transept. De chaque côté de la porte s'avance un contrefort ; on y a adossé deux petites chapelles dédiées à Notre-Dame de Tongres et à Notre-Dame de Grâce. Au-dessus de la porte s'ouvrait une grande fenêtre ogivale, que l'on a murée ; plus haut, la date 1551 est gravée en relief sur la façade, sous les monogrammes du Christ et de la Vierge ; ces chiffres, qui jadis étaient rehaussés d'une couleur noire, sont assez difficiles à lire aujourd'hui. Les nefs latérales ne sont point contemporaines du reste de l'édifice; les murs extérieurs furent démolis, reconstruits et rehaussés en 1661. Le chœur et les croisillons furent alors simplement restaurés ; leurs fenêtres ont pour amortissement du bouquet, qui ne se reproduit pas aux ouvertures des bas-côtés. L'abside est consolidée par trois contreforts, près desquels on a érigé un calvaire. Le clocheton recouvert d'ardoises qui surmonte l'église date de la seconde moitié du siècle dernier.
Les boiseries qui garnissent le pourtour de l'église proviennent, comme les quatre confessionnaux et cinq médaillons sculptés, de l'ancienne chapelle des Carmes. La chaire, fort médiocre, représente un ange enfermant la bête de l'Apocalypse. Il n'y a que trois autels. Le principal est orné d'un tableau représentant la Vierge délivrant les âmes du purgatoire ; il est signé E. Quellinus fec. 1658 et appartenait jadis à l'église de Saint-Jean-Baptiste, à laquelle il avait été donné par la confrérie des Trépassés. Les bas-autels sont dédiés, l'un à la sainte Trinité, l'autre à la sainte Vierge. On remarque à ce dernier une belle statue donnée par Delvaux, qui a cru devoir en constater l'authenticité par l'autographe suivant (encadré à la cure) : « Je sousigne et déclare d'avoir donné à la | paroisse de St Jean –l 'Evangéliste à Nivelles à | l'exclusion de tout autre l'image de la Ste Vierge | sous le tittre de N. Dame de Remède en sculpture, | et bénite le lendemain de la Pentecotte 1760 | par le très Révérend Doïen Mr Dubois du noble | et vénérable chapitre de Nivelles à la chapelle | du petit St Jacques, d'où ensuite elle fut recon | duite en procession à la dite paroisse. | En foi de quoi j'ai signé ce présent billet. | Laur. Delvaux | sculpteur D : A : R : ». Dans le collatéral droit on voit un tableau représentant la bienheureuse Marie d'Oignies, qui est signé d'un écu portant une tête de cheval et que l'on attribue à Crayer. Cette peinture provient du prieuré d'Oignies et a été offerte à l'église de Nivelles par M. Soteau, doyen de Bruxelles. Nous citerons encore, pour ne rien omettre, quatre tableaux d'un mérite secondaire : un Christ et une Vierge de Lons, un saint Louis de Gonzague et un saint Jérôme du peintre bruxellois Delvaux, mort en Italie en 1822. On voyait autrefois, à l'entrée du chœur, un autel dédié à Notre-Dame de Remède, où se desservaient les messes de la chapellenie de Sainte-Catherine et où se trouvait un tableau représentant la Rédemption des captifs, don d'un M. Gilbert. De l'autre côté, à l'autel Sainte-Anne ou du bénéfice Saint-Nicolas, le tableau avait été donné par la famille Jeuzainne et était estimé plus de cent patacons.
On conserve dans la sacristie une châsse en argent, renfermant les reliques de sainte Marie d'Oignies, qui a été donnée à sa ville natale par M. Pierlot, dernier prieur du monastère d'Oignies. Le 15 juillet 1817 le clergé de Saint-Nicolas, accompagné d'un grand nombre de fidèles, est allé processionnellement recevoir la châsse des mains des anciens religieux d'Oignies, à la chapelle de Sainte-Barbe au faubourg de Mons. La commune d'Aiseau, au territoire de laquelle appartenait le prieuré, ayant réclamé contre cette cession, l'autorité ecclésiastique conseilla une transaction, qui fut agréée : la châsse, avec le corps de sainte Marie, resta à Nivelles ; un buste, renfermant la tête de la bienheureuse, retourna à Aiseau. Cette châsse, qui a la forme ordinaire, date du commencement du XVIIe siècle, comme l'indique l'inscription suivante : Me fieri fecit rdus | dns. dns. reynerus | anno 1608 | Stensels prioratus sut A0 primo, | Elle est revêtue de dix panneaux en argent repoussé, encadrés de cuivre, qui figurent des épisodes de la vie de la sainte. Treize statuettes d'argent, paraissant plus anciennes que le reliquaire, en décorent les diverses faces et sont accompagnées chacune d'une petite légende :
1° Salvator munidi salva nos 2° S. Petre, 3° S. Paule, 4° S. Thoma, 5° S. Joannes, 6° S. Jacobe, 7° S.Simon, 8° S.Mathœe, 9° S. Mathia, 10° S. Philippe, 11° S. Bathome, 12° S. Andréa, 13° S. Jacobe.
La petite place qui entoure l'église, et qui communique avec les rues Saint-Maurice, des Pécheurs et Fausse porte, ne représente plus qu'un reste de l'ancien cimetière, qui servait, non seulement à la paroisse, mais à celle de Saint-Jean-Baptiste, où il n'y en avait pas, à l'hôpital Saint-Nicolas et à la Maison de la Charité.
Comme l'église de Saint-Nicolas, celle du Saint-Sépulcre était, dans le principe, l'oratoire d'un hôpital contigu, qui portait le même nom. En 1231, on exempta cet hôpital du paiement des émoluments qu'il devait au desservant de cette église, qui fut alors érigée en paroisse, et, d'autre part, l'hôpital n'y conserva que la moitié des offrandes, aux quatre grandes fêtes de l'année. En 1586 on réduisit l'église au rang d'annexé de là paroisse de Saint-André. Vainement les trois membres de la ville, en considération du grand nombre de personnes qui en habitaient les alentours, réclamèrent son érection en cure, avec des maîtres d'église et des maîtres des pauvres pour la banlieue (résolution du 9 octobre 1596). Les paroissiens, qui étaient alors plus nombreux, dit-on, que ceux de toute autre église de Nivelles, venaient de la restaurer et de la rebâtir, dans l'espoir de parvenir un jour à un meilleur résultat, lorsqu'ils apprirent qu'il était question de leur enlever leur chapelain. A leur demande, l'évêque enjoignit aux curés de Nivelles de placer au Saint-Sépulcre un chapelain à résidence fixe, chargé de célébrer la messe, d'entendre les confessions etc. (8 novembre 1613). En 1787, c'était une succursale de Notre-Dame. Le desservant recevait : des trois curés de Nivelles, une compétence de 136 florins, et de l'hôpital du Saint-Sépulcre, pour donner des soins spirituels aux malades, 30 fl. Son revenu total s'élevait à 314 fl. Il y avait en outre six bénéfices simples : ceux de Sainte-Agnès, de Saint-André et Sainte-Catherine, de Saint-Philippe et Saint-Jacques, de Saint-Nicaise, plus un cinquième (de Saint-Biaise) et un sixième (de la Vierge), chargés respectivement de 50, 12, 12, 52, 156 et ? messes, par an. Fermée et mise en vente du temps des Français, l'église fut comprise, en 1803, au nombre des succursales de la cure de Braine-l'Alleu, et on lui assigna pour juridiction le faubourg de Namur et tout le restant de la banlieue, de la porte Sainte-Anne à celle de Charleroi. Supprimée lors la réduction des curés, elle ne fut rouverte qu'en 1809, comme succursale de Saint-Nicolas, à l'extérieur de la ville ; le conseil communal avait offert d'assurer au prêtre qui la desservirait un traitement annuel de 800 francs ; le préfet approuva cette demande, mais en proposant la réduction du traitement à 500 francs (17 janvier 1809). La fabrique est actuellement propriétaire de trois hectares.
L'église du Saint-Sépulcre est située au faubourg de Namur, au bord de la grand'route, sur laquelle s'ouvre un portail latéral fort simple, de style renaissance, accompagné de la date 1788. Cet édifice, qui a 27 mètres de long sur 19 de large, affecte aujourd'hui la disposition d'une basilique à trois nefs. Le chœur est de style ogival et se termine par un mur plat, dont les angles sont remplacés par des pans coupés ; il est éclairé par quatre fenêtres ; on en a muré une cinquième, qui se trouvait derrière le maître autel et était surmontée d'un oculus. Le chœur a été bâti en 1615 ; il est moins élevé que la nef centrale, avec laquelle il communique par une grande ouverture en ogive ; il est surmonté d'un plafond portant la date 1714. La grande nef est la partie la plus ancienne de l'église ; elle est séparée de chacun des collatéraux par deux piliers carrés revêtus de moulures modernes et divisant le vaisseau en trois travées ; sur ces piliers retombent des arcades ogivales, qui datent probablement de l'an 1013, époque où on réédifia ou restaura cette nef. Au-dessus de ces arcades on distingue encore, dans chacun des murs de la nef, quatre fenêtres en plein cintre, de forme allongée, qui ont été bouchées au siècle dernier et qui appartenaient probablement au temple primitif. Ces ouvertures n'avaient pas encore été supprimées en 1749, car une vue cavalière de l'église, qui remonte à cette année et qui se trouve dans les archives du bureau de bienfaisance, les représente très exactement. Le plafond de la nef est décoré de trois cartouches qui renferment lès inscriptions suivantes :
1° Cette | atée (sic) donné | par Anne Camus | sœur | a l'hospital ;
2° J'ai aimé | l'embellissement | de vostre | maison ;
3° Votre | sepUL-Chre | o Mon DIeU est | gLorleUX ;
le chronogramme formé parcelle dernière inscription donne la date 1732.
Les nefs latérales, qui sont éclairées chacune par trois fenêtres en plein cintre, ont été reconstruites à la fin du XVIIIe siècle, comme l'indiquent les dates inscrites aux plafonds : 1769 à la nef droite, 1788 à la nef gauche ; M. Goffia, curé de Bornival et doyen du canton de Nivelles, a béni les deux nefs le 2 octobre 1788. Ces travaux de restauration ou d'agrandissement ont été faits sans beaucoup de soin: le collatéral gauche est un peu plus large et moins long que celui de droite ; les murs extérieurs ont été bâtis en briques, au lieu d'avoir, comme les parties anciennes de l'édifice, un revêtement en pierres blanches ; enfin les rampants du toit de la grande nef ont été prolongés en ligne droite vers le sol, de manière à recouvrir d'un seul égout une moitié de cette nef et un bas-côté, et à masquer complètement les anciennes fenêtres dont nous avons parlé plus haut. On remarque des traces d'une fenêtre de même forme à l'extrémité orientale du collatéral droit ; ce qui prouve que la reconstruction s'est bornée au mur méridional.
Le maître-autel, ou autel du Saint-Sacrement, est orné d'un beau tabernacle en bois sculpté, de style renaissance, qui provient de l'église des Carmes et a, dit-on, été exécuté par un religieux de cet ordre ; on peut lui faire faire un demi-tour sur lui-même, et alors les colonnes qui le décorent disparaissent et font place à des pilastres. On y remarque un beau Christ en cuivre. La statuette, représentant la Religion, qui surmonte le tabernacle, est l'œuvre de Delvaux. Au-dessus du maître-autel est placé un tableau, peint en 1619, qui représente le Sauveur déposé au Saint-Sépulcre ; aux deux côtés se trouvent des tableaux plus petits, reproduisant des apparitions du Seigneur aux apôtres. Le chœur est garni de boiseries jusqu'aux fenêtres.
Les bas-autels sont en marbre ; ils proviennent de Saint-Paul et sont dédiés l'un à la Vierge, l'autre à Saint-Joseph. Ils ont remplacé, en 1788, quatre autres autels, qui étaient consacrés, dans la nef droite, à Saint-Blaise et à N.-D. de Montaigu ; dans la nef gauche, à N.-D. des Sept-Douleurs et à N.-D. de Grâce ; c'est à ces autels que les bénéficiers se déchargeaient de leurs obligations : le 1er était affecté au bénéfice de Saint-Biaise, le 2e au bénéfice de Saint-Jacques et Saint-Philippe, le 3e au bénéfice de Sainte-Agnès et à celui de Sainte-Gertrude, le 4e au bénéfice de Saint-Nicaise et à celui de Sainte-Catherine et Saint-André. Ce qui est singulier, c'est de ne rencontrer aucun autel placé sous l'invocation de Saint-Paul apôtre, qui est le patron de l'église et dont on célèbre la fête le 25 janvier, jour de la conversion de ce saint.
On remarque, au bas de l'église, de belles orgues, accompagnées d'une balustrade en bois sculpté figurant des trophées de musique, qui ont appartenu à l'église Saint-Jacques. Sous le jubé existe encore le treillis qui servait de communication entre l'église et l'hôpital du Saint-Sépulcre.
Le confessionnal du bas-côté droit provient de l'église des Carmes ; celui de gauche, de Notre-Dame. Deux médaillons en bois viennent également des Carmes ; quatre autres ont été donnés par M. Darras. Une Vierge portant Jésus, petite sculpture qui se trouvait jadis dans la chapelle de N.-D. des Sept-Douleurs, est attachée à un pilier de la nef, près de la chaire. Ce dernier objet, le seul peut-être dans l'église qui ait été exécuté pour la place qu'il occupe, est dû à Manesse. Le pavement contient plusieurs dalles tumulaires brisées ou effacées du XVe et du XVIe siècle. Aucune inscription n'est intéressante ; la plus ancienne qui soit complète remonte à 1538.
On conserve au Saint-Sépulcre les reliques de saint Blaise, qui étaient en tel honneur, dit-on, auprès des ouvriers en laine, qu'à certains jours ils se pressaient en cortège depuis le faubourg jusqu'à la Grand'Place. La sacristie remonte à 1779. La cure a été reconstruite, en 1855, sur les plans de M. Jamart.
D'après la plus ancienne légende de sainte Gertrude, l'église de Saint-Paul existait déjà au VIIe siècle. Une vision ayant averti les religieuses ou chanoinesses qu'elles ne devaient plus laisser des hommes reposer dans le lit de la bienheureuse fille de Pépin, l'abbesse Agnès, accompagnée de toute la communauté, porta ce lit, en cérémonie, dans la basilique dédiée à saint Paul. Selon toutes les probabilités, ce vieux temple tomba en ruines et resta dans l'abandon, car on mentionne l'église de Saint-Paul comme nouvellement construite et consacrée, dans un diplôme du 8 avril 992, par lequel le roi Othon III, à la demande d'Adelhéïde, son aïeule, et de l'évêque de Liège Notger, dota ce temple de quinze manses situées à Ardenelle et des édifices, terres cultivées et terres incultes qui en dépendaient. L'église servait d'oratoire aux chanoines, qui y célébraient leurs offices particuliers. Le soin de le desservir et particulièrement de célébrer l'anniversaire de l'évêque Huard (Hugues de Pierrepont) était confié à deux chapelains, à chacun desquels les chanoinesses Alide de Henripont et Mélisende léguèrent : la première, en 1225, 4 deniers ; la seconde, en 1232, 6 deniers. Ils officiaient à tour de rôle, nuit et jour, chacun pendant une semaine. D'après une déclaration du chapitre, en date du mois d'avril 1269, c'était le custos ou sacristain qui instituait ces deux chapelains, entretenait en bon état les murailles, la toiture, les portes, les vitraux, les cloches, les vêtements sacerdotaux et les ornements de Saint-Paul, et fournissait du luminaire à l'autel Saint-Paul et à l'autel Saint-Thomas. Le chapitre s'étant adressé à l'official de Liège pour que ces deux chapelains et le sacristain fussent exemptés de la juridiction de l'ordinaire, comme pris dans son sein (octaves de Pâques, en 1304), un avis en ce sens fut donné par le doyen et le concile de Fleu-rus, le mardi avant l'Ascension de la même année.
Dans la suite, les fonctions de sacristain de Saint-Paul furent réunies à celles du prévôt du chapitre, qui à ce titre jouissait d'un tiers : 1° de la dîme des terres de la commanderie de Vaillampont (dîme dont les chanoines de Saint-Paul prélevaient les deux autres tiers) ; 2° des dîmes de Grambais ; 3° de dix bonniers de terres, appelés les Terres de Biamont, à Houtàin-le-Val, et 4° des offrandes de l'église. En 1787, la fabrique lie Saint-Paul n'avait que 112 florins de revenu.
Cet édifice occupait l'angle de la place dite l'Aire Saint-Paul et du Marché au Bétail ; il était séparé du jardin abbatial par le passage appelé la Ruelle des Amourettes, et de l'église Notre-Dame par une petite pl.ice plantée d'arbres. Il ne consistait qu'en un seul vaisseau long de 100 pieds, et formé de six travées, dont, la première offrait du côté du sud une entrée, avec un petit porche. Les trois dernières travées constituaient le chœur, qui était entouré par les stalles destinées aux chanoines. La nef ne comprenait que deux travées et on y voyait deux petits autels, adossés aux stalles dont nous venons de parler.
En mai 1603 on travaillait à la reconstruction de l'église, qui fut restaurée et modernisée à la même époque que la collégiale. Là se trouvait sans doute ce chapiteau de Saint-Paul, qui fut exécuté le 22 août 1441, aux frais des chanoines résidants ; chacun d'eux se cotisa à 620 plaques ou 10 florins 6 plaques 16 deniers), soit ensemble à 310 florins. On lisait à Saint-Paul l'inscription suivante : « Chy gist | noble homme Gérard de Marbais escuier | en son temps sgn de Lovrval, de Baileirs | de Prelle et de Villers la Pottes, qui | tréspassa l'an de grâce mil iiij . iiij . LXX iij | le X de jan-vier | Chy gist noble femme damoiselle | Laurenche de T'Serclaes espousse au devant dict | Gérard qui trespassa l'an de grâce | mil iiij Lxxiij le xe jour du mois | d'octobre ».
Une décision de l'administration centrale du département de la Dyle, du 5 prairial an IV, mil l'église de Saint-Paul a là disposition de la municipalité, pour la célébration des fêtes décadaires. Une réclamation du doyen Brehaye fut rejetée le 9 du même mois, et le Temple de la loi ouvert, le 20, par la célébration de la fête de la Victoire. Quelques années après, l'édifice fut démoli et son emplacement servit à agrandir l'Aire-Saint-Paul, devenue momentanément la Place Verte ou Place du roi de Rome.
L'église de Notre-Dame, ancienne église mère de Nivelles, fut jusqu'en 1231 l'unique paroisse du territoire de cette ville et de Thines. Suivant toute apparence, Baulers, Lillois, Witterzée, Monstreux en ont constitué d'autres démembrements ou dépendances. Son curé eut toujours sur les autres pasteurs de Nivelles un droit de préséance, qui lui fut encore confirmé par le chapitre, le 18 avril 1641. C'était à Notre-Dame qu'on distribuait les saintes huiles aux paroisses de la ville et qu'on mariait les chanoinesses. Lorsqu'elles étaient en prison, ces demoiselles ne pouvaient entendre la messe que là ou à Saint-Paul.
La paroisse de Notre-Dame, qui était d'abord circonscrite par les rues Sainte-Anne et de Soignies, le Marché et le Marché aux Bêtes, s'accrut successivement : en 1586, de celle de Saint-Cyr, et en 1753, de celle de Saint-André. En 1787, le curé avait 1,687 florins de revenu, parmi lesquels figuraient : 895 florins, formant les deux cinquièmes du produit de la grande et de la petite dîme aux faubourgs de Bruxelles, de Mons et de Charleroi (dont les deux autres curés prélevaient : celui de Saint-Jean deux cinquièmes, celui de Saint-Jacques un cinquième). Ces deux derniers curés lui payaient : le premier, deux couples de chapons ; le second, une couple ; et le curé de Thines un muid de froment. Par contre il payait : à un vicaire, pour compétence, 200 florins ; au vicaire de la succursale du Saint-Sépulcre, 64 florins ; à celui de Saint-Jean-Baptiste, 100 florins. Sur la demande du curé, qui se plaignait d'avoir de lourdes charges à supporter, le conseil de Brabant lui adjugea, le 16 juillet 1791, un supplément de compétence s'élevant à 200 florins, payables : trois neuvièmes par le chapitre, trois neuvièmes par l'hôpital du Sépulcre, un neuvième par l'hôpital Saint-Nicolas et deux neuvièmes par l'état de Saint-Paul.
Au dix-septième siècle, on ne connaissait à Notre-Dame aucune fondation particulière. Deux cantuaires, ceux de Sainte-Anne et de Saint-Nicolas et Sainte-Catherine, dotés, celui-ci de dix, celui-là de treize mesures de seigle, et la matriculaire (ou office de sacristain), avec un revenu annuel de 15 florins par an, y furent assignés au curé, en 1607, à charge de célébrer une messe par semaine. Un bénéfice de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine, doté de 96 florins par an et chargé d'une messe par mois, y fut transféré lors de la fermeture de l'église Saint-André. Le revenu de la fabrique s'élevait, en 1787, à 1,373 florins. L'antique basilique de Sainte-Marie, où Sainte-Gertrude, d'après ses biographes, priait habituellement, avait été plusieurs fois reconstruite lorsqu'elle fut démolie au commencement de ce siècle. Elle s'élevait à une faible distance du Marché au Bétail, entre une petite place, vers l'église de Saint-Paul, et un cimetière qui la séparait du Marché et de la collégiale. Elle consistait en une nef et un chœur. La nef n'avait que quatre travées, et, à gauche, un collatéral, dont elle était séparée par des piliers ; une travée et une petite abside a trois pans constituaient le chœur, qui avait à gauche une sacristie, surmontée d'une chambre où logeait le sacristain. La nef avait 90 pieds de long sur 65 de large, le chœur 31 pieds de long sur 28 de large. On entrait dans l'édifice par trois portes, toutes trois placées à l'extrémité de la nef : la porte vers les cloîtres, au-dessus de laquelle étaient les orgues ; celle vers Saint-Paul ; et celle dite : Par où passe la procession, qui subsiste encore dans une écurie contiguë à l'Académie de dessin, et appartient, par son ornementation, au style gothique tertiaire. Outre le maître autel, il y avait un autel de Notre-Dame du Rosaire dans le collatéral, et un autel de la Nativité, au premier pilier de ce collatéral.
Le collatéral dont nous venons de parler fut ajouté en 1413. L'église ayant été reconnue insuffisante, le chapitre en autorisa les mambours, le 26 février de cette année, à annexer à l'édifice une partie du cimetière situé du côté de Saint-Paul (rethro ecclesiam Beatie Mariae, versus sanctum Paulum), et le 30 juin suivant, le chanoine Jean Trichiert les invita à reconnaître que ce terrain faisait partie du patrimoine de Sainte-Gertrude et qu'aucun cadavre ne pourrait y être enseveli sans une permission spéciale. En l'année 1657 seulement on remplaça la couverture en paille de l'église par une toiture d'ardoises. En l'année 1772, les paroissiens insistèrent énergiquement sur l'état de vétusté du temple et en demandèrent la reconstruction ; on projeta à cette époque d'en placer le chœur contre le pignon du cloître et l'entrée du côté du Marché au Bétail (18 juillet 1775), mais ce projet fut ensuite abandonné. Les travaux furent achevés l'année suivante aux frais des décimateurs, et coûtèrent : aux prévôt, doyen et chapitre : 8,294 florins ; à l'hôpital du Saint-Sépulcre, 3,616 florins. L'église fut bénite et rendue au culte le 15 août 1777. Un quart de siècle s'était à peine écoulé que l'antique oratoire disparut pour toujours. Fermé d'abord, puis rendu au culte par ordonnance du 15 pluviôse an VI, il fut remplacé lors du concordat par la collégiale, dont il devint la propriété. Vendu à M Marloy, au commencement de l'année 1813, on le transforma en une habitation particulière en y établissant des étages et des cloisons. C'est la maison qui fait le coin de la place Saint-Paul et du Marché au Bétail et devant laquelle se trouve un petit jardin clôturé par une grille en fer.
La salle au-dessus de la sacristie avait été bâtie par une dévote, qui fut autorisée à y habiter, le 21 lévrier 1659, « sans que cela put tirer à conséquence ».
Le cimetière communiquait jadis avec la salle capitulaire. Le jour des onze mille vierges, en l'année 1292, l’official de Liège autorisa le chapitre à condamner cette issue, pour le cas où les plébans de Nivelles y consentiraient. L'empereur Joseph II ayant défendu d'enterrer à l'intérieur des villes, le cimetière même fut supprimé, et, après quelques contestations, cédé à la ville pour être réuni à la voie publique, à la condition que la juridiction y appartiendrait comme par le passé au chapitre, sauf toutefois que le magistrat y aurait la police (24 avril 1793).
A proximité du mont-de-piété actuel, on voyait jadis une église dédiée à Saint-André, et dont le ressort comprenait la partie de la ville que limitent les rues de Sainte-Anne et de Bruxelles et le Marché aux Bêtes ; quelques maisons situées hors de la porte de Bruxelles reconnaissaient également l'autorité spirituelle de son pasteur. L'église du Saint-Sépulcre en devint une annexe à la fin du XVIe siècle. Les autres curés de la ville ayant obtenu de l'évêque la suppression de cette paroisse, les paroissiens, auxquels les trois membres se joignirent (4 janvier 1034) s'y opposèrent avec succès ; mais, en 1754, l'église fut supprimée et on en prescrivit la fermeture. Elle fut démolie vers l'année 1760, et le terrain acheté par les religieux d'Orival, qui établirent en cet endroit leur refuge, devenu depuis le mont-de-piété.
Il existait à Saint-André une chapellenie de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine (ou simplement de Sainte-Catherine, en 1282), chargée d'une messe par mois, et un autel de Sainte-Anne, sans fondation. Une confrérie de Saint-Joseph y fut érigée le 18 mars 1676.
Les paroissiens de Saint-André ornèrent l'église, en 1561, d'un nouveau clocher, et, le 2 novembre 1612, conclurent un accord avec Marc Pereu pour la construction d'un beffroi. Le temple avait été profané en 1558 et réconcilié six ans plus tard.
A l'angle de la rue de Namur et de la rue de l'Evêché s'élevait jadis l'église de Saint-Jean-Baptiste, dite aussi Saint-Jean des Maisiaux (des Masiauls) ou des Boucheries (S. Joannes macellorum). Erigée en paroisse en 1231, conservée en cette qualité en 1586, elle fut réduite en 1753 à n'être plus qu'une chapelle, succursale de Saint-Jean-l’Evangéliste. Le 5 juillet 1726, quelques pauvres paroissiens de ce temple avaient réclamé, pour lui, le maintien de ses antiques prérogatives. Sa circonscription, accrue de la paroisse Saint-Georges, s'arrêtait aux maisons de la rue de Bruxelles, du Marché aux Bêtes et de la rue de Charleroi.
En 1787, le curé avait 742 florins de revenu ; vers 1640, le revenu de la fabrique était de 408 florins 18 sous 12 deniers, sur lesquels on payait 200 fl. 18 s. au curé et 76 fl. 2 s. au clerc. Il y existait une chapellenie de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine, qui était chargée de 26 messes par an et avait 139 fl. de revenu. Le 15 février 1425, sire Jean Jamaul, prêtre, légua 120 couronnes de France, pour y fonder à l'autel de Notre-Dame deux messes, à célébrer l'une tous les mardis, et l'autre tous les jeudis. Le 10 juin 1522, Gertrude de Herzelles légua une rente de 50 francs pour fonder une messe de onze heures à Saint-Jean-Baptiste. Une confrérie en l'honneur de Saint-Roch y fut érigée par le curé, les mambours et les paroissiens, dotée d'indulgences, et enfin approuvée par le chapitre les 6 et 7 août 1626 ; une autre, dite des Trépassés ou de N.-D. des Suffrages, y fut installée le 3 juill. 1643.
L'église Saint-Jean-Baptiste avait environ 25 mètres de longueur et se terminait vers le nord-est par une abside à trois pans. Cet édifice a subi des transformations assez singulières. Le chœur n'a pas été modifié : on y voit encore, aux trois faces du chevet, une grande fenêtre ogivale que deux meneaux divisent en lancettes : cette partie de l'église sert aujourd'hui de magasin à fourrages. Le chœur communiquait avec la nef par une grande ouverture ogivale. Sur l'emplacement de la nef on a bâti une maison, ce qui a nécessité la reconstruction du mur septentrional, faisant façade vers la rue de Namur; mais, chose surprenante, on a laissé subsister toute l'ancienne toiture de la nef et du chœur. Cette charpente ogivale est fort curieuse : les moulures qui la décorent, les figures sculptées dont on l'avait ornée, et parmi lesquelles on remarque Moïse tenant le livre de la loi, prouvent qu'elle était destinée à être vue des fidèles. Elle présente en outre la particularité assez rare d'être datée : sur l'entrait de la ferme qui s'élève à la jonction du chœur et de la nef est entaillé le millésime M XVe XIII. Malgré l'élégance de ces combles, on ne leur a pas fait grâce à l'époque de la renaissance et l'on découvre encore des traces d'un plafond destiné à les dérober aux regards ; le chœur a été moins heureux encore, car le crépi a été appliqué immédiatement contre les chevrons. Nous venons de dire que le mur septentrional de l'église avait été démoli ; il n'en est point de même du mur méridional, qui longe une petite cour et se trouve percé de trois arcades ogivales supportées par des colonnes à chapiteau fort simple. On ne peut expliquer cette disposition qu'en admettant l'existence d'un collatéral unique ; car, pour en établir un second, il eût fallu supprimer la rue de Namur. Et en effet, une asseinte fut bâtie en 1616, au lieu où étaient le fournil et lignier (ou magasin au bois) de la cure, dont la propriété avait été cédée par le curé à la fabrique, le 21 mai 1614.
Il ne reste aucun vestige de l'église de Saint-George, dont l'emplacement est occupé en partie par la maison de la veuve du notaire Coulon, rue de l'Evêché. Il s'y trouvait une chapellenie de Sainte-Catherine et de Saint-Nicolas, qui n'était chargée que d'une messe par quinzaine. Le 18 août 1547, la chambre des comptes accorda 20 livres pour faire bâtir une asseinte et chapelle, « au coin de l'église Saint-Georges, vers le Vieux « Cimetière », parce que la base du mur de ce côté commençait à tomber eu ruine. Dépouillée de ses droits paroissiaux au profit de l'église de Saint-.Jean-Baptiste, en 1586, celle de Saint-George fut bientôt convoitée par plusieurs corporations religieuses. Le chapitre la refusa aux sœurs grises, qui auraient voulu l'incorporer à leur cloître (9 juin 1614. Les jésuites essayèrent ensuite d'en devenir possesseurs. Les paroissiens ayant abandonné leurs droits sur le maître-autel, les trois autres autels, la chaire et les autres ornements qui s'y trouvaient, réclamèrent les deux cloches et les fonts baptismaux, et demandèrent en outre que le bénéfice de Sainte-Catherine et Saint-Nicolas fût transféré à Saint-Jean-Baptiste. Un décret épiscopal leur fit don de la grosse cloche, d'une table d'autel, des fonts baptismaux, des deux cimetières contigus à l'église et du revenu de la chapellenie précitée (9 décembre 1620). Malgré les démarches des jésuites et de leurs protecteurs, l'évêque Dauvin leur refusa d'abord l'église Saint-George et le chapitre intima à ces religieux l'ordre d'en rendre les clés ; ils refusèrent d'accéder à cette dernière injonction, en ajoutant qu'ils parleraient au prélat. Celui-ci consentit enfin à leur abandonner l'église, avec ses deux cimetières et ses autres dépendances, confirma aux paroissiens de Saint-Jean-Baptiste la possession de tout ce qui leur avait été assigné, les cimetières exceptés, et ajourna toute décision sur la translation de la chapellenie (25 septembre 1621). En 1636, l'église se composait d'une nef en forme de rotonde, et d'une abside composée de deux travées et présentant deux oratoires latéraux.
L'église de Saint-Maurice, à laquelle ressortissait jadis la partie sud-est de la ville et le faubourg Al Saulx, fut fermée pendant les troubles de religion : le 25 août 1581, le chapitre la céda aux jurés pour la sépulture des pestiférés ; puis, de concert avec les curés des autres paroisses, la donna en location à Thierri Van der Beken (13 mai 1591), qui la remplit de bois et d'autres matériaux, profanation dont les habitants du voisinage se plaignirent vainement au chapitre. A quelque temps de là, une congrégation d'annonciades obtint de l'évêque la cession de ce temple, mais à la condition que les ornements et les deux cloches appartiendraient à la paroisse de Saint-Jean-l'Evangéliste, à laquelle celle de Saint-Maurice avait été réunie en 1586. Les annonciades s'opiniâtrant à garder ces objets, malgré les ordres de l'évêque, les paroissiens offrirent de se contenter d'une cloche ; le prélat accueillit cette proposition et enjoignit à la mère ancelle du couvent de s'y conformer, sous peine d'être poursuivie par l'official (6 août 1610).
Une chapellenie de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine, chargée d'une messe par semaine, était annexée à la paroisse de Saint-Maurice. D'après une ancienne tradition, dont les Chroniques manuscrites de Nivelles se font toutes les échos, un enfant de Louis XI, roi de France (selon les uns, son fils Joachim ; selon d'autres, sa fille Anne), naquit à Nivelles, et fut baptisé à Saint-Maurice. Ce détail erroné (voyez l'article Genappe) fut probablement mis en circulation au dix-septième siècle, après la fondation près de ce temple d'un couvent d'annonciades, ordre dont l'établissement est dû à Jeanne de Valois, autre enfant de Louis XI. On ajouta alors une circonstance miraculeuse : on prétendit que Jeanne fut avertie, par une vision, que son ordre serait suivi dans le temple où sa sœur avait reçu le baptême. Cet édifice occupait à-peu-près l'emplacement des maisons du géomètre Lebrun et du médecin Pigeolet, rue Saint-Maurice.
Dans une petite impasse de la rue de Mons, un peu plus haut que la fontaine dont le sommet est décoré de la statue du patron de l'Espagne, près de l'endroit où s'élève aujourd'hui l'hospice des orphelins, a existé l'église paroissiale de Saint-Jacques (Sanclus Jacobus, in vico Montensi, 1231).
L'église de Saint-Jacques fut longtemps une des plus importantes de Nivelles. Sa circonscription comprenait la léproserie de Willambroux, où le curé de Saint-Jacques avait le droit d'entendre les confessions ou de faire remplir ces fonctions par un autre prêtre, qu'il pouvait révoquer s'il se montrait insolent à son égard. La paroisse s'étendait plus loin encore et ne s'arrêtait qu'au bois du Petit-Roeulx. En ville, elle était limitée par les maisons adjacentes à la rue de Soignies, au Marché et à la rue du Wichet. Le curé de Saint-Jacques avait, en 1787, 950 florins de revenu, provenant : d'un cinquième de la dîme des curés de Nivelles, de 136 fl. que le chapitre lui allouait (50 fl., en vertu d'une résolution du 24 juillet 1687, pour supplément de compétence, 86 fl. pour le loyer d'une habitation) etc. En 1641, le revenu de la fabrique s'élevait à 334 fl. 8 sous, sur lesquels on payait : au curé 99 fl. 5 sous, au clerc 65 fl. 6 sous. On avait fondé à Saint-Jacques deux chapellenies, celle de la Division des Apôtres, qui était dotée de 15 muids de seigle et chargée de 3 messes par semaine, et celle de la Vierge ou de Notre-Dame du Pilier, qui était chargée d'une messe par quinzaine et avait, en 1787, 135 fl. de revenu. Une confrérie des Trois-Rois s'y établit en vertu d'une autorisation du chapitre, du 2 janvier 1676.
L'ancienne église renfermait plusieurs tombes curieuses et des vitraux peints. Le maire de Nivelles, Jean de Herzelles qui mourut le 8 mars 1524-1525, et son père y firent placer, au-dessus du maître-autel, un vitrail représentant une Apparition de l'apôtre saint Jacques, lors d'une bataille livrée en Espagne contre les Musulmans. Le fils de Jean, Adrien, sire de Moensbroeck, mort en 1548, se fit représenter sur une fenêtre voisine de l'autel des Douze-Apôtres, accompagné de sa femme, de ses enfants et des saints Adrien et Jacques. L'inscription suivante y existait encore au siècle dernier : Cy gist | Messire Bernard de Spote, en son temps | chevalier seigneur de Spote et du petit | Roeulx qui trépassa l'an M.CCC. et IIIIxx XVIII | Et | Madame Ysebeau d'Arkennes sa | Femme qui trépassa l'an M. CCC. et | IIIxx et ung, le premier jour de Jenvier | Priex pour leurs âmes.
De grands travaux furent entrepris dans cette église sans en améliorer l'état : vers l'année 1700, on y voûta la chapelle de Notre-Dame du Pilier ; sept ans plus tard, on renouvela le grand autel ; de 1725 à 1730, le clocher fut restauré. Néanmoins, le 10 février 1757, le curé et les mambours prévinrent les habitants que le temple était en danger imminent de crouler, et quelques jours après les offices cessèrent et se célébrèrent dans l'église conventuelle des Carmes. Un architecte demeurant à Bruxelles, Thibaut, fut consulté, et reconnut la nécessité d'étayer le pilier qui menaçait ruine. Les travaux de restauration, auxquels le chapitre consacra pour sa part 4,000 florins, furent achevés en 1762. Supprimée pendant la domination française, l'église fut vendue en 1843 à M. Desloges, puis démolie.
Le curé De Coux ayant cité devant le conseil de Brabant le chapitre de Nivelles, les mambours et les paroissiens de Saint-Jacques, les trois membres de la ville et le curé de Notre-Dame, pour qu'ils eussent à lui procurer une cure convenable, le conseil décréta que, si la suppression de la paroisse ne s'effectuait pas, cette charge incomberait pour deux tiers aux insinués, pour le tiers restant au curé lui-même (13 septembre 1774). C'est de ce chef que le chapitre payait au curé de Saint-Jacques, en 1787, une allocation spéciale de 86 florins par an
L'église de Saint-Cyr, située au faubourg, près de l'endroit où se trouve aujourd'hui la station du chemin de fer, était écartée du centre de la ville ; ce désavantage était compensé par l'immense étendue de la circonscription de la paroisse, qui comprenait les lieux dits : les Wailles, Grambais, le Bois du Sépulcre, la Tournette, le Laid patard, le Petit bois de Nivelles, le Spinoy, et qui, en 1586, fut soumise à l'autorité spirituelle du curé de Notre-Dame. Le pouillé de l'an 1441, dont nous avons déjà parlé, y mentionne deux chapellenies, celles de Notre-Dame la grande et de Sainte-Catherine. Une donation de l'an 1282 mentionne « l'œuvre de l'église Saint-Soire et les deux chapelles de ce temple ».
Au commencement du XVI siècle, on reconstruisit l'église de Saint-Cyr. Une somme de 12 livres fut alors donnée par les rentiers, les jurés et le conseil de Nivelles aux curé, mambours et paroissiens, allant pourchasser (ou quêter) pour la réfection du temple. Mais ce dernier disparut pendant les guerres de religion. On en remit les ornements, le 12 avril 1585, au chapitre, qui abandonna les ruines de l'église au magistrat, afin de les employer à réparer les remparts (12 juin 1592), puis autorisa les annonciades à utiliser ce qui en subsistait encore, après qu'on y aurait pris tout ce dont on avait besoin pour restaurer la trésorerie de Sainte-Gertrude (24 avril 1609). Une petite partie des débris de Saint-Cyr servit, en 1634, à édifier la chapelle Saint-Roch, en vertu d'une autorisation octroyée par la ville, qui accorda en outre un subside à cet effet (le 20 mai). C'est pour cela sans doute que les membres du magistrat devinrent les mambours de la nouvelle chapelle. Un ermite voulut s'y installer, mais, à la demande des habitants du voisinage, défense fut faite par le chapitre au curé de Notre-Dame de sanctionner un fait de cette nature (20 août 1682). En 1787, la chapelle était desservie par trois bénéficiers :le chapelain de Sainte-Elisabeth, qui était chargé de 33 messes par an et doté d'un revenu de 174 florins ; celui de Notre-Dame de Saint-Cyr, qui était chargé de 2 messes par semaine et doté d'un revenu de 109 florins ; et le possesseur d'un cantuaire, qui était chargé d'une messe par semaine.
Dans le jardin du docteur Lebon, au pied de l'emplacement de l'ancienne église de Saint-Cyr, on remarque, entre les plates-bandes, plusieurs petits chapiteaux octogones, ornés de deux écussons sans armoiries; une vieille table en pierre, également octogone, est sans doute l'abaque d'un autre chapiteau de plus grande dimension.
A proximité de la Thines, dont elle n'était séparée que par un jardin, a existé l'église de Notre-Dame de Gouthal ou Goutta, qui fut érigée en paroisse en 1231, détruite pendant les troubles, supprimée en 1586 et réunie alors à la paroisse Saint-André. Elle eut pour dernier curé messire Philippe Collardt, à qui le domaine paya 2 livres d'Artois, en 1576-1577, pour avoir pris soin des nobles oiseaux (ou oiseaux de proie) du Bois de Nivelles. Il existait à Gouthal trois autels avec fondations, ceux de Sainte-Agnès, de Saint-Nicaise et de Saint-Nicolas ; les deux premiers chargés, celui de Sainte-Agnès d'une messe par mois, celui de Saint-Nicaise, d'une messe par quinzaine, furent transférés a l'église du Saint-Sépulcre ; on réunit la dotation du troisième à celle du Séminaire de Nivelles. Dès l'année 1232, une chanoinesse nommée Mélisende donna 6 deniers de rente au chapelain de l'autel de Sainte-Agnès de Gotallo. Vers le même temps, Alide de Henripont fonda un autre bénéfice, qu'elle dota de 24 bonniers de terres, situés à Lillois, à Baisy, à Hattain et à Ardenelle.
Le curé du Saint-Sépulcre ayant aliéné à vil prix le journal de terre sur lequel s'élevait jadis l'église de Goutta, les mambours de la paroisse s'en plaignirent à l'évêque ; ils firent remarquer qu'on avait extrait de ce terrain une grande quantité de matériaux, qu'il en restait encore beaucoup, le tout représentant une valeur plus que sextuple du prix de vente ; que de plus on avait exhumé et jeté ignominieusement une masse d'ossements. Le 1er mars 1692 intervint un décret par lequel l'évêque interdisait à l'acquéreur de continuer ses travaux, sans une autorisation préalable. Celle-ci ne fut jamais réclamée sans doute, car, en creusant les fondements de la cité ouvrière de Goûta, dans une prairie appartenant aux hospices, on a trouvé d'autres ossements et on a découvert les substructions de l'ancienne église, qui avait environ 8 mètres de largeur.
Dans la partie du territoire de Nivelles qui dépend de la paroisse de Monstreux, on trouvait jadis la Chapellerie Notre-Dame de l'Espinette, qui fut rebâtie, «en meilleure forme », aux frais du curé et des paroissiens de Monstreux, et au moyen des aumônes recueillies par le chanoine Jean Dou Puche. Cet ecclésiastique obtint à cet effet de l'hôpital Saint-Nicolas, avec le consentement du chapitre, la cession d'un bonnier de terre (18 mars 1472). Il institua dans cette chapelle une messe hebdomadaire, qui se disait le lundi, et légua le soin de protéger sa fondation à l'abbesse de Nivelles. Dans la suite, le bénéfice de Notre-Dame de l'Espinette fut annexé au cantuaire de l'abbesse, dans la collégiale. Dans la partie septentrionale du territoire nivellois, près de la ferme du Spinoit, s'élève la Chapelle de Saint-Pierre, surnommée à Broquettes, parce que les femmes stériles y vont en pèlerinage et poussent dans la niche une petite broquette. Comme elle se trouve dans la paroisse de Monstreux et que le bénéfice qui vêtait jadis fondé avait été uni à la chapelle abbatiale de Sainte-Gertrude, on pourrait supposer que cet édifice est identique au précédent.
Dans la première partie du XVIe siècle, un bourgeois, nommé Jean Forlay, qui était simple d'esprit et que l'on surnommait pour cette raison Hacquinot de Sainte-Anne, entreprit la construction d'une chapelle dédiée à la mère de la Vierge. Bien qu'on lui observât qu'il y avait déjà assez d'oratoires et d'autels élevés sous cette invocation, il persista dans son dessein, et parcourut le pays, en quêtant de ville en ville. Etant arrivé à Anvers alors qu'on y avait ouvert une magnifique loterie, il se procura un billet, moyennant trois patars, et eut le bonheur de gagner le grand prix, qu'il revendit très cher à une chanoinesse. Tout l'argent réuni par ce bourgeois fut employée bâtir la Chapelle de Sainte-.Anne, qui a donné son nom à celui des faubourgs de Nivelles qui se trouve du côté de Hal.
On en commença la construction le 22 mai 1534 et un suffragant de Liège la consacra le 13 mai 1533. En 1558, on y exécuta encore des travaux, pour lesquels le domaine accorda quatre chênes, le 26 septembre. Les gueux l'ayant profanée, elle fut réconciliée par l'évêque de Namur François Buisseret, en 1609. Le 1er mai 1775, un des successeurs de ce prélat, à la demande du chapitre et du curé de Notre-Dame, permit delà démolir, ainsi que plusieurs stations voisines, par la raison qu'elle ne servait qu'à quelques libertins. D'ailleurs il ne s'y célébrait que quatre messes par an.
Au bord oriental du chemin de Tubise, à l'endroit où se rejoignent deux sentiers, dont l'un vient de Nivelles, et l'autre du Bois du Sépulcre, s'élève sur un plateau une petite maison isolée, dont les murs, construits en pierres de taille, révèlent l'ancienneté. Au-dessus de la porte on a encastré une pierre sculptée, unique vestige encore subsistant de la chapelle dont nous venons de parler. Cette pierre, plus large que haute, est divisée en deux panneaux par un balustre : à droite est représentée sainte Anne, à gauche la Vierge avec l'Enfant Jésus. Le bas-relief est surmonté d'une inscription en caractères gothiques : 15 XVe XXXI . le . XXIle de may fut le premier comencemet de cette | cappelle et la 33 fut beneitte et côsacree le 13e de May le mardi . le . fôdateur . ôt. | . ordonnes . la . Messe . le . mardi et pluseur . beaulx . miracles . aproves . pnt . due . et cures .
La chapelle Sainte-Anne était jadis très fréquentée le mardi, surtout le mardi après Pâques ; elle a été remplacée, en 1814, par la Chapelle de Notre-Dame de Walcourt, qui se trouve à 200 mètres N. de la Maison Sainte-Anne.
Vis-à-vis de la cité ouvrière de Goûta, à l’E. du chemin qui va vers Saint-Jean (et qui se nomme encore chemin de Bohème), entre la villa Bomal et Tivoli, s'élevait jadis la Chapelle de Notre-Dame de Bohême, qui existait encore au commencement de ce siècle.
Dans les premières années du XIIIe siècle, Hugues d'Orliens (ou Orléans) et Berthe sa femme donnèrent aux frères de l'hôpital (ou de Saint-Jean de Jérusalem) une église voisine de Nivelles, avec 45 bonniers de terres, 4 manoirs (curiœ), un moulin et un étang. Cette donation n'eut pas de suite : Hugues la révoqua et l'abbé de Saint-Aubert de Cambrai et le doyen de la cathédrale de cette ville la déclarèrent nulle, par le double motif qu'aucune cession de biens féodaux ne pouvait avoir lieu que du consentement du seigneur suzerain, et que pour l'institution d'un chapelain dans l'église précitée, l'autorisation du grand maître de l'ordre des Hospitaliers était nécessaire (février 1212-1213).
Dès l'année 1210, les biens de Hugues et de sa femme, repris dans le fief de Rognon (de feodo Rognon), et qui comprenaient un moulin, des habitations, des jardins, des terres, des prés, des eaux, etc., furent abandonnés par eux à l'abbaye d'Aywières, du consentement du suzerain immédiat de Hugues, le chevalier Hugues d'Arquennes, et de son seigneur supérieur, Godefroid, châtelain de Bruxelles, agissant en qualité de tuteur d’Othon, seigneur de Trazegnies. De son côté, Aywières s'engagea à donner à Hugues, tous les ans, à titre viager, deux chariots de foin, 8 sous de Nivelles, deux chapons, 40 muids de blé (10 de froment, 20 de seigle et 10 d'avoine), et à lui abandonner, pour une moitié et sans frais, le produit de 20 bonniers de terres. Les mêmes avantages, mais réduits de moitié, furent assurés à Berthe, dans le cas où elle survivrait à son mari. C'est en vertu de cette transaction, qui fut sanctionnée en l'an 1219 par le seigneur de Trazegnies, devenu majeur, et en septembre 1231, par l'évêque de Liège, que les religieux d'Aywières acquirent la propriété du moulin de Clarisse et des terrains environnants.
La Chapelle de Saint-Jean-Baptiste, près de Nivelles (Capella prope Nivellam, 1231), ou de Saint-Jean-décollé, resta aux Hospitaliers ou chevaliers de Malte) et fut considérée depuis comme une dépendance de leur maison, ou commanderie de Vaillampont, qu'ils obtinrent des ducs de Brabant, après la suppression des templiers. De cette chapelle provint le nom du hameau qui se forma au Franc-Etau et dont nous avons raconté les vicissitudes et l'organisation. Selon Gramaye, cette chapelle et le bien voisin de Neuve-Rue auraient été donnés à l'ordre, en l'an 1174. Lorsque ce compilateur écrivait, l'oratoire avait été récemment restauré, par les soins du commandeur de Chantraine ou de Vaillampont. Suivant la tradition, plusieurs de ces dignitaires de l'ordre y ont reçu la sépulture. On l'a démolie presqu'entièrement en l'année 1760
Le corps de logis de la ferme Saint-Jean occupe l'emplacement de cet ancien oratoire. La partie qui subsiste formait l'extrémité occidentale de l'édifice et a une forme rectangulaire. Le mur terminal, du côté de l'ouest, qui donne sur un chemin creux descendant vers le Ri-Michaux, est primitif. Il présente un vieux pignon, en pierres de marne brutes, d'une énorme épaisseur, soutenu par des contreforts massifs et percé de petites baies. Le mur oriental, vers la cour, est moderne; on a noyé dans la maçonnerie deux grosses colonnes cylindriques, peu élevées, qui se montrent au dehors. A l'intérieur on aperçoit quatre colonnes semblables, dont deux sont placées contre les parois latérales et les deux autres engagées dans le pignon occidental. Ces deux rangées de trois colonnes prouvent que l'édifice se composait de trois nefs et qu'il avait une certaine importance. Dans les fondements de la grange, pour laquelle on a employé les débris de l'oratoire, on trouve des bases de colonnes qui correspondent sans doute à celles que nous venons de signaler. Les habitants de la ferme, dans le langage populaire, s'appellent encore les Saint-Jean.
Au-delà du hameau formé par la ferme Saint-Jean et les habitations voisines, au milieu des champs cultivés, on aperçoit la Chapelle de Notre-Dame des Sept-Douteurs, qui a été reconstruite il y a quelques années. L'ancien oratoire datait, à ce qu'il semble, du XVe siècle. L'évêque de Cambrai, de Berghes, y institua une confrérie, qui fut rétablie eu 1596. Le 15 octobre 1558, la chambre des comptes accorda un chêne aux maîtres, gouverneurs et confrères de la chapelle de Notre-Dame des Sept-Douleurs emprès Nivelles. Jadis il s'y disait toutes les semaines trois messes, que l'on réduisit ensuite à une, que les récollets y célébraient le dimanche ; on y officiait aussi les jours de fêtes, et le prêtre célébrant était alors rétribué au moyen des aumônes faites à la chapelle. La fabrique avait, en 1789, 36 florins de revenu. Une demeure contiguë abritait anciennement deux ermites, que le curé de Notre-Dame désignait. Sur un plan du siècle dernier, conservé aux archives du bureau de bienfaisance, on voit, près de la chapelle, un monticule (tumulus?), surmonté d'une croix. La république française mit en vente l'oratoire, dont on démolit les trois autels, le 9 mai 1798.
La Chapelle de Notre-Dame du Mont-Carmel « hors la porte Alsaux», était nouvellement bâtie, lorsque le 9 août 1633, le chapitre y autorisa l'érection d'une confrérie. Elle est située au bord oriental de la route de Charleroi, au milieu d'un petit massif d'arbres. Elle a été récemment reconstruite dans le style ogival, comme nous l'apprend la date : « 10 septembre 1854 », inscrite sur l'édifice. Ce petit monument est de forme octogone ; ses huit faces ont un revêtement de cailloux de sable ; quatre sont pleines et les autres percées de trois fenêtres et d'une porte. Chacun des huit angles saillants est cantonné d'un contrefort en briques, surmonté d'un pinacle.
La chapelle est le but d'un pèlerinage fréquenté ; il s'y fait chaque année une procession, le dimanche après l'octave de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel.
La Chapelle de Saint-Pierre, au faubourg Del Saulx, doit son origine aux offrandes des bourgeois qui avaient visité Rome et le tombeau du chef des apôtres. C'était là qu'on allait à Pâques chercher le Saint-Chrême, indice, dit Gramaye, d'une haute antiquité. Elle fut restaurée après les troubles de religion, et, vers l'année 1809, le vicaire-général Forgeur autorisa le curé du Saint-Sépulcre à la rouvrir, quoiqu'elle ne pût contenir qu'une vingtaine de personnes. En 1824, on y disait encore la messe, de temps en temps. Aujourd’hui elle sert d'habitation et est tellement délabrée qu'elle est à peine reconnaissable. On y distingue cependant les restes de deux fenêtres ogivales en briques. La porte est surmontée d'une accolade, au-dessus de laquelle est placée une tête d'ange de style renaissance. A l'intérieur, le plafond est orné des clefs de saint Pierre.
Lorsque Joseph II ordonna la suppression des cimetières situés à l'intérieur des villes, le magistrat désigna, pour servir de cimetière commun à tous les habitants de Nivelles, une prairie située à côté de la chapelle Saint-Pierre, d'une étendue de 3 journaux 80 verges. Le chapitre aurait désiré avoir un lieu d'inhumation particulier, mais le magistrat répondit, le 6 août 1784, qu'il n'était pas en son pouvoir d'accorder une pareille faveur. Le terrain appartenait à l'hôpital du Saint-Sépulcre et fut acquis par les trois paroisses alors existantes, au moyen d'un prêt de 4,610 florins que leur fit la caisse de religion. On commença à y ensevelir le jour de la Toussaint 1784.
Le cimetière, entouré d'un mur, se trouve à l'angle de la route de Charleroi et du chemin de la Tour Renard, sur le plateau qui domine la ville vers le S. E. Une grille, s'ouvrant au N. sur le chemin de la Tour Renard, y donne accès. L'aspect du cimetière est navrant : point d'arbustes, point de fleurs, pas même de sentiers ; les mauvaises herbes ont tout envahi. La négligence va si loin que l'on ne s'est pas même donné la peine de relever deux grandes dalles sépulcrales qui sont tombées, il y a cinq ou six ans, au pied de la muraille à laquelle elles étaient scellées ; cela témoigne d'une profonde indifférence pour ceux qui ne sont plus de ce monde.
Au milieu du cimetière s'élève, sur une base cubique, une colonne cannelée dont le fût est brisé. On lit, sur une des faces du piédestal :
Aux braves | morts | pour la patrie en | 1830 ;
et, sur une autre, cette heureuse citation de Virgile : .... Egregias animas, quœ sanguine nobis Hanc patriam peperere suo, decorate supremis Muneribvs... AENEID. XI, 24.
Le célèbre sculpteur Delvaux, qui était enterré dans l'église conventuelle des carmes, devant la chaire sculptée par lui, repose dans ce cimetière. Sa famille y a fait placer, contre le mur qui borde la route de Charleroi, une plaque de marbre blanc, avec l'inscription suivante :
D. 0. M. | Sub hoc tumulo | iacet | laurentius delvaux | sac. caes. maiest. | nec non | ducis lotharingiœ | sculptor | obiit VI kal. martias | anni a christo I CDDCCLXXVlll | œtatis suce | LXXXlll | R.I. P.
Citons encore les épitaphes suivantes :
Monumentum | nobilis familiœ | de Prelle de la nieppe | Ici reposent Madame de Prelle née de Biseaux, | décédée le 26 août 1817, à l'âge de 66 ans. | et de monsieur Bernard de Prelle son | époux, décédé le 14 février 1845, à l'âge de | 85 ans, six mois, Ils laissent après eux le | souvenir de leur piété et de leurs vertus.
A la mémoire | de Monsieur François de Le hoye décédé à Nivelles, le 30 | 9bre 1819 après avoir donné l'exemple de toutes les vertus | pendant 63 ans | de madame Pauline de Prelle épouse de monsieur Louis | de Le hoye décédée à Nivelles le 31 janvier 1853, vivement | regrettée de sa famille, et de tous ceux qui ont connu | sa piété, sa charité et ses excellentes qualités.
D. O. M. | Ci devant reposent | Thomas Philippe Marcq ecuyer licencié | es droits mort le âgé de | et dame Marie Louise Otto son épouse | morte le .... âgée de .... | et demoiselle Marie Anne Marcq leur | fille morte le 12 de 7bre 1791 âgée de | 20 ans onze mois.
Icy gist | Mre Nicolas | Couttume Bour | geois de cette | ville decede | le 8 de may | 1665. Acquiesçât | in pace.
Mentionnons enfin les tombes de : Baudouin-Joseph-Ghislain Berlaimont, ancien échevin au magistrat de Nivelles, sous-préfet et ensuite sous-intendant de l'arrondissement de Nivelles, mort le 7 mars 1823, âgé de 69 ans 8 mois ; et de François-Joseph Gilain, mécanicien, né à Dinant, le 6 septembre 1784, mort à Nivelles le 9 juin 1842.
La chapelle Sainte-Barbe, au faubourg de Mons, est la principale après celles du Mont-Carmel et des Sept-Douleurs, mais elle n'a rien qui mérite d'être décrit. Nous renvoyons à l'article Charité ce que nous avons à dire des chapelles de Sainte-Marie-Madeleine et de Notre-Dame de Roblet, mais nous ne pouvons passer sous silence la fondation dite du Petit Catéchisme, faite le 30 octobre 1598, par l'abbesse Marie de Hoensbroeck. Cette dame légua 50 florins de rente à une ou deux filles dévotes, à charge d'enseigner les filles pauvres. La prévôté, le maître et la maîtresse de la fabrique de Sainte-Gertrude avaient la surintendance de cette fondation.

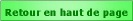
 |
Avec le soutien de la Province du Brabant Wallon |

